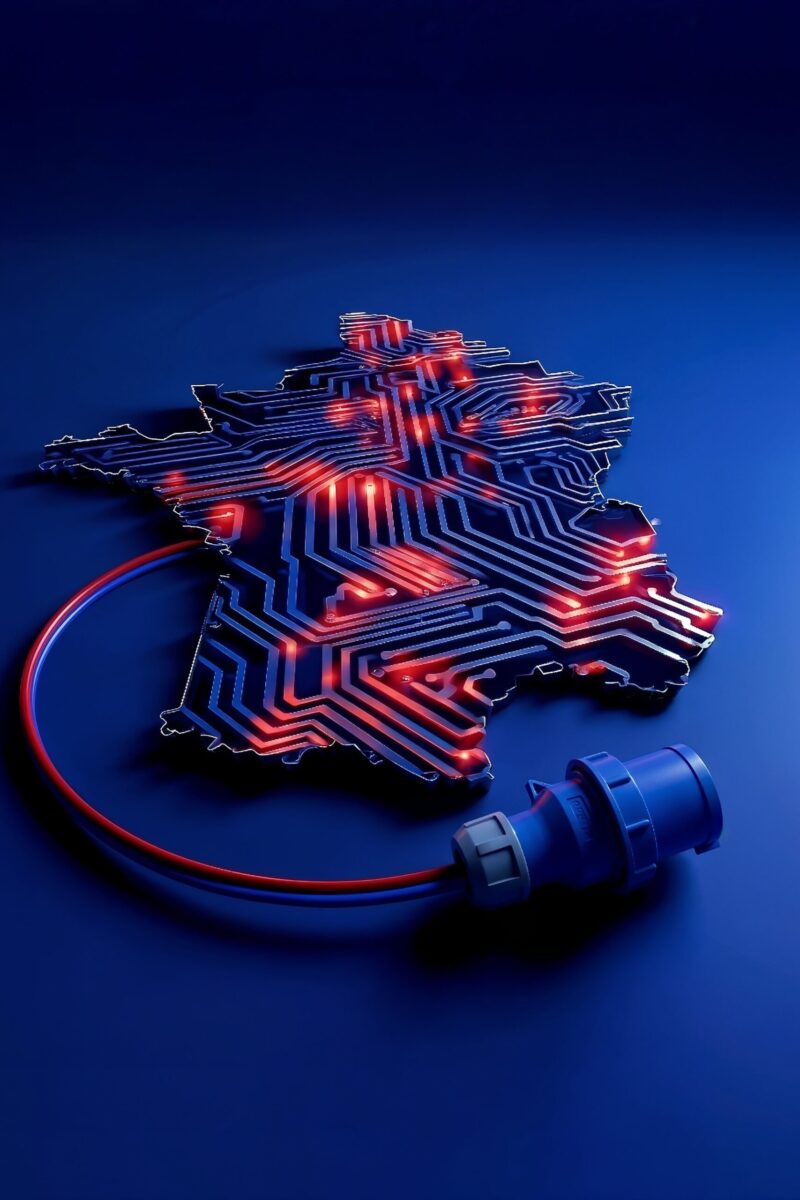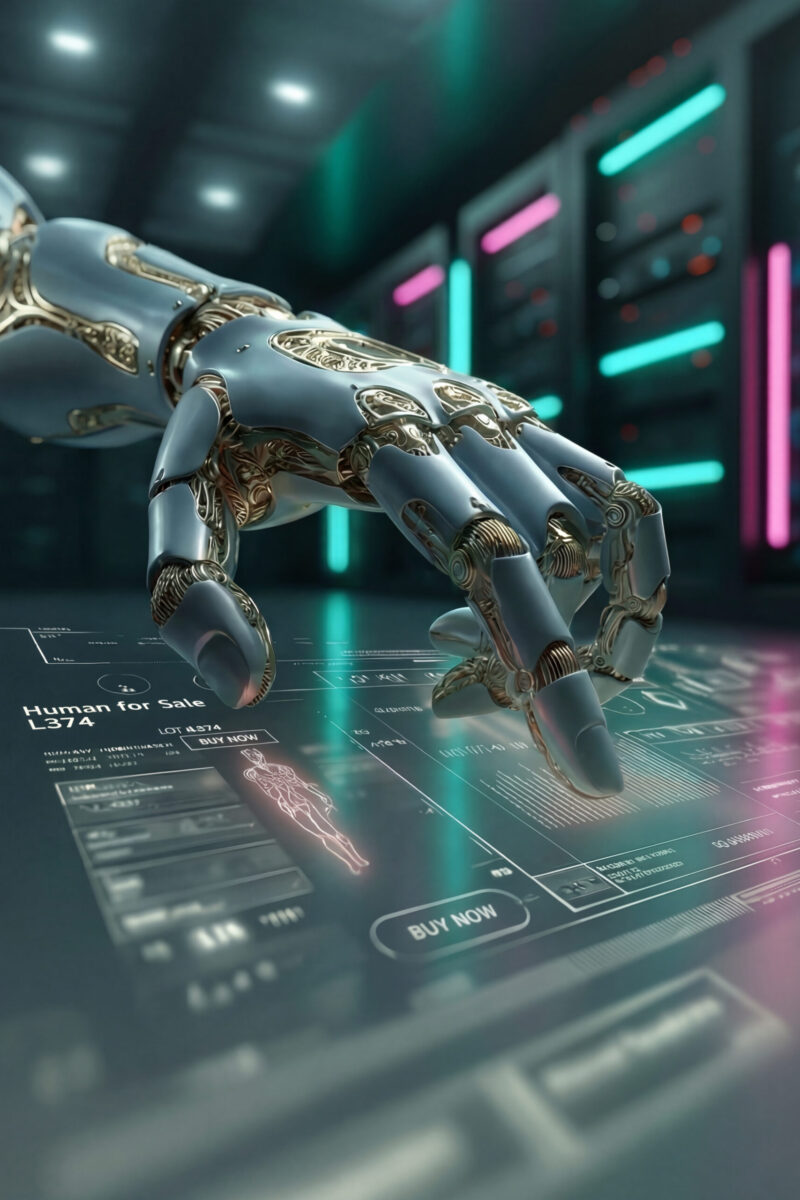Le monde vit désormais en état de crise permanente. Doit-on subir, renoncer, s’habituer ? Il y a 1 800 ans, un empereur trouvait des clefs pour ne pas devenir esclave du chaos.
« Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. » La main qui trace cette phrase tremble légèrement, pas de peur, mais de froid. Nous sommes vers 172 après J.-C., quelque part le long du Danube. Dans une tente militaire mal éclairée, Marc Aurèle écrit en grec sur un carnet qui n’était pas destiné à nous parvenir.
L’empereur romain fait face à des choix impossibles. La guerre s’éternise et nécessite des fonds. Les provinces, affaiblies par la peste, peinent déjà à payer leurs impôts. Dans ces conditions, toute décision implique de faire souffrir quelqu’un. Augmenter les taxes dans des territoires exsangues, ou laisser la frontière s’effondrer faute de renforts. Il n’écrit pas pour convaincre ni pour transmettre. Il écrit pour empêcher les circonstances extérieures de prendre le contrôle sur ce qu’il juge juste de faire, même lorsque toutes les options sont mauvaises.
Marc Aurèle n’a jamais cherché le pouvoir. Formé très jeune à la philosophie stoïcienne, il aurait sans doute préféré une vie d’études et de retrait. Mais il hérite du trône en 161, précisément au moment où l’Empire commence à se fissurer. Les crises s’empilent. La peste affaiblit durablement les populations, les guerres aux frontières se multiplient, les tensions politiques internes s’exacerbent. Gouverner ne consiste plus à améliorer un système relativement stable, mais à contenir un effondrement lent, fait d’arbitrages impossibles et de décisions prises avec des informations toujours incomplètes.
Très vite, l’intuition s’impose, profondément inconfortable : il n’y aura pas de retour à la normale. Pas de moment idéal où tout redeviendra simple. La crise n’est pas une parenthèse, mais le terrain même sur lequel il va falloir agir.