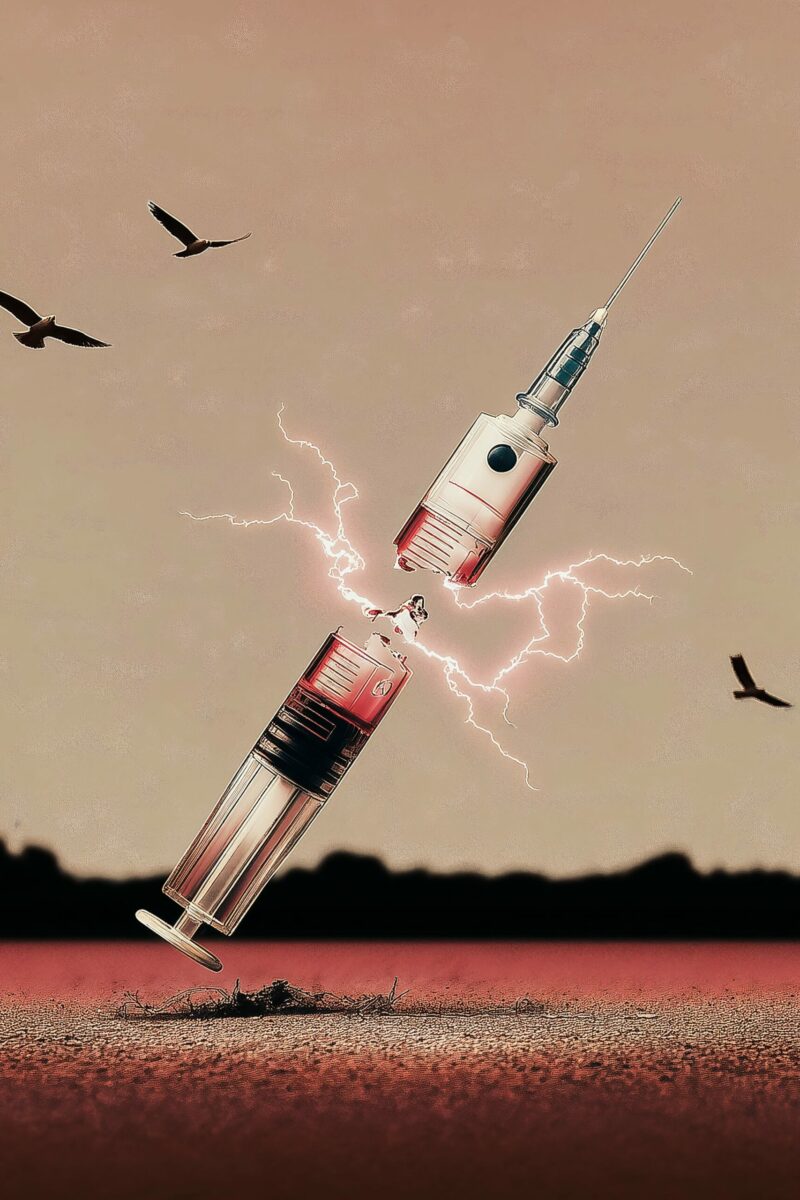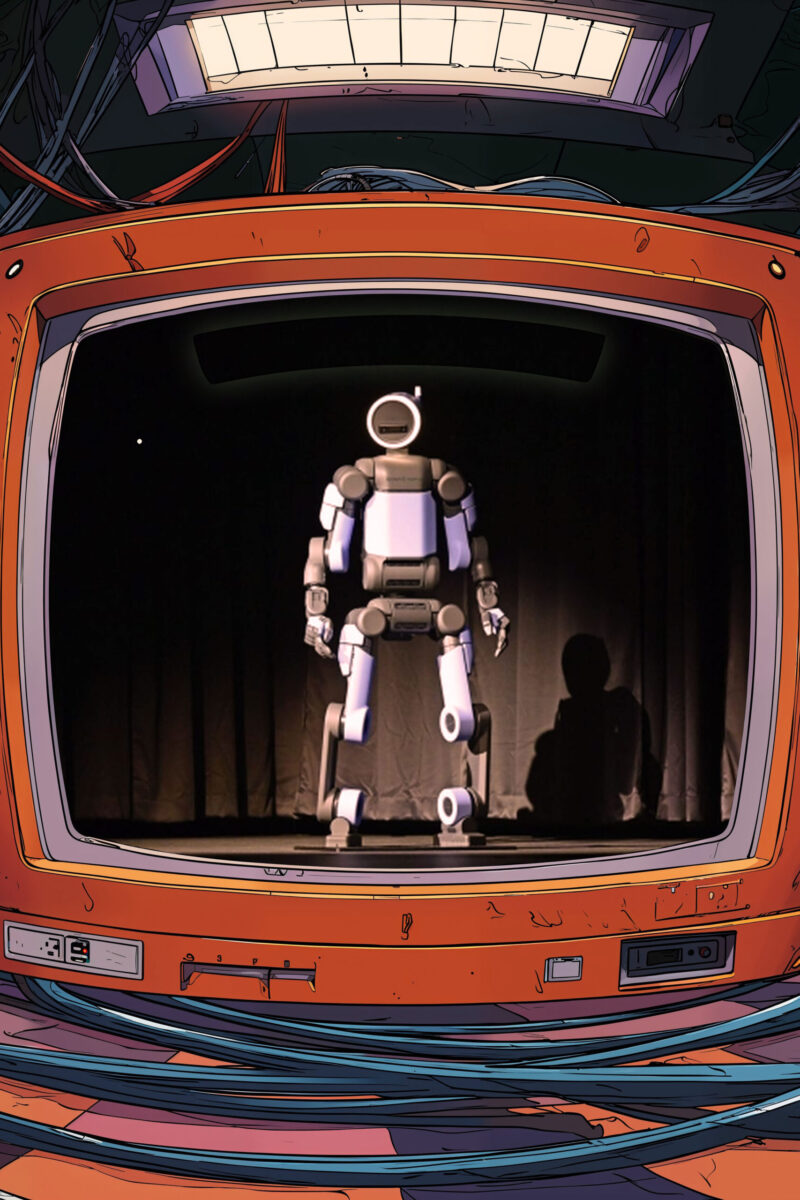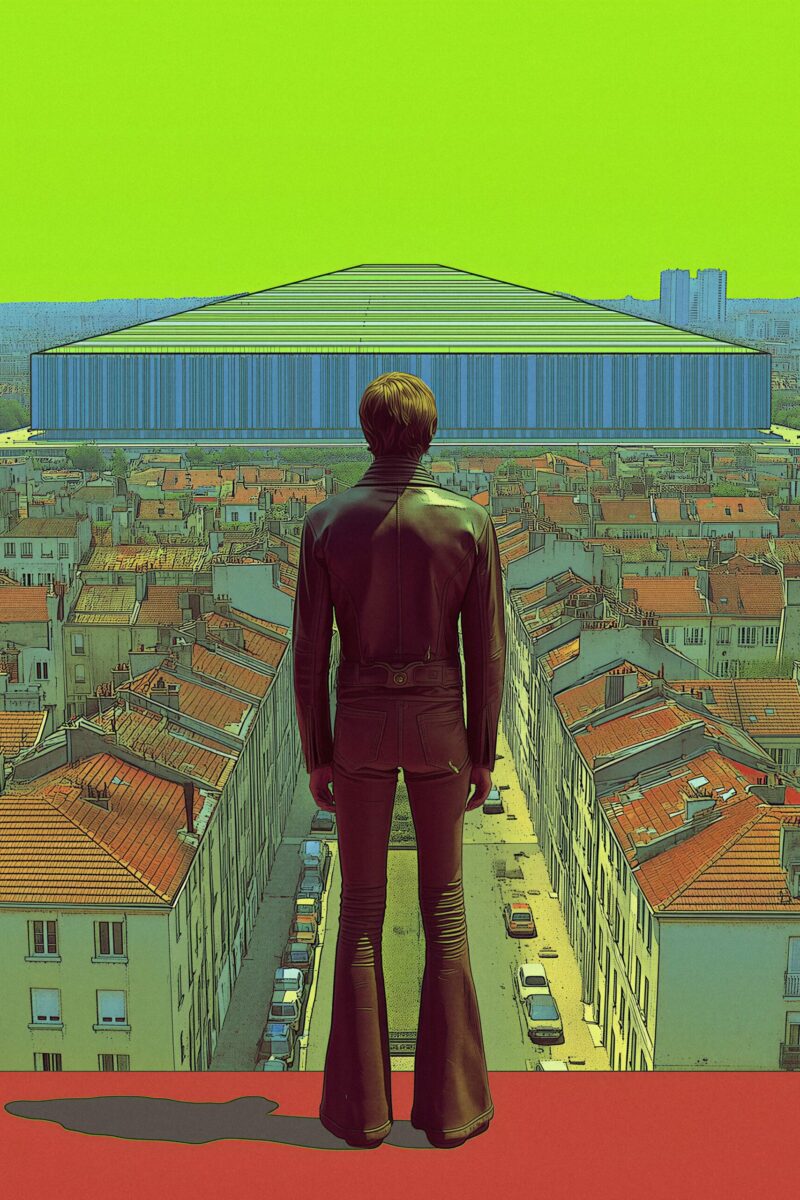Ils n’avaient ni ordinateurs, ni béton armé, ni lasers. Ils ne connaissaient même pas le zéro. Pourtant, au Ier siècle, les Romains ont bâti un aqueduc de 50 km, avec une pente au quart de cheveu et un ouvrage qui défie encore le temps : le Pont du Gard.
Quand l’eau devient civilisation
Cette prouesse technique est aussi un manifeste. Car du Pont du Gard à nos centrales nucléaires, une civilisation se définit par ce qu’elle ose construire.Pourtant, au Ier siècle de notre ère, Nîmes ne manquait pas d’eau. La source de la Fontaine, à partir de laquelle furent bâtis les jardins emblématiques de la ville au XVIIIᵉ siècle, et de nombreux puits alimentaient déjà la cité, même en période d’étiage. Ce qui n’empêcha pas les élites locales de souhaiter doter l’orgueilleuse cité d’un aqueduc. Ce choix ne répondait pas seulement à un besoin pratique, mais à une ambition politique et culturelle. Dans l’Empire romain, disposer d’un aqueduc signifiait rejoindre la « civilisation des eaux » : l’abondance pour les fontaines, l’hygiène par le nettoyage permanent des égouts, la sociabilité des thermes. L’aqueduc incarnait l’entrée dans un mode de vie romain, où l’eau n’était plus une ressource rare, mais un élément structurant du confort urbain et de la grandeur collective.
Cette décision illustre combien les infrastructures étaient déjà pensées comme des marqueurs de civilisation. À travers elles, une cité pouvait se hisser au niveau des plus illustres villes romaines et afficher son appartenance au monde impérial. L’eau ne servait pas seulement à boire, elle servait à être romain.
Le chantier pharaonique des Gaulois romanisés
Conduire l’eau de la source d’Eure, près d’Uzès, jusqu’à Nîmes représentait un défi technique et logistique : tracé sinueux de cinquante kilomètres, franchissement du Gardon par un pont monumental, percées en tranchées et en tunnels. Un chantier pharaonique. Plus de onze millions de pierres taillées furent assemblées, vingt-cinq mille tonnes de chaux produites dans des fours le long du parcours, des milliers de mètres cubes de sable et de gravillons acheminés.
Ce n’étaient pas des légions désœuvrées ni une armée d’esclaves qui bâtirent l’ouvrage, mais des entreprises spécialisées, réparties par lots. On y trouvait des maçons, des tailleurs de pierre, des charpentiers pour les échafaudages, des charretiers pour le transport, et même, pour soulever les blocs, des grutiers utilisant les célèbres « cages d’écureuil » : un treuil actionné par une grande roue en bois, de trois à six mètres de diamètre, dans laquelle un homme marchait comme un hamster dans sa roue. La construction du pont lui-même dura environ cinq ans — à peine trois fois moins que pour aboutir à la déclaration d’utilité publique de l’A69…