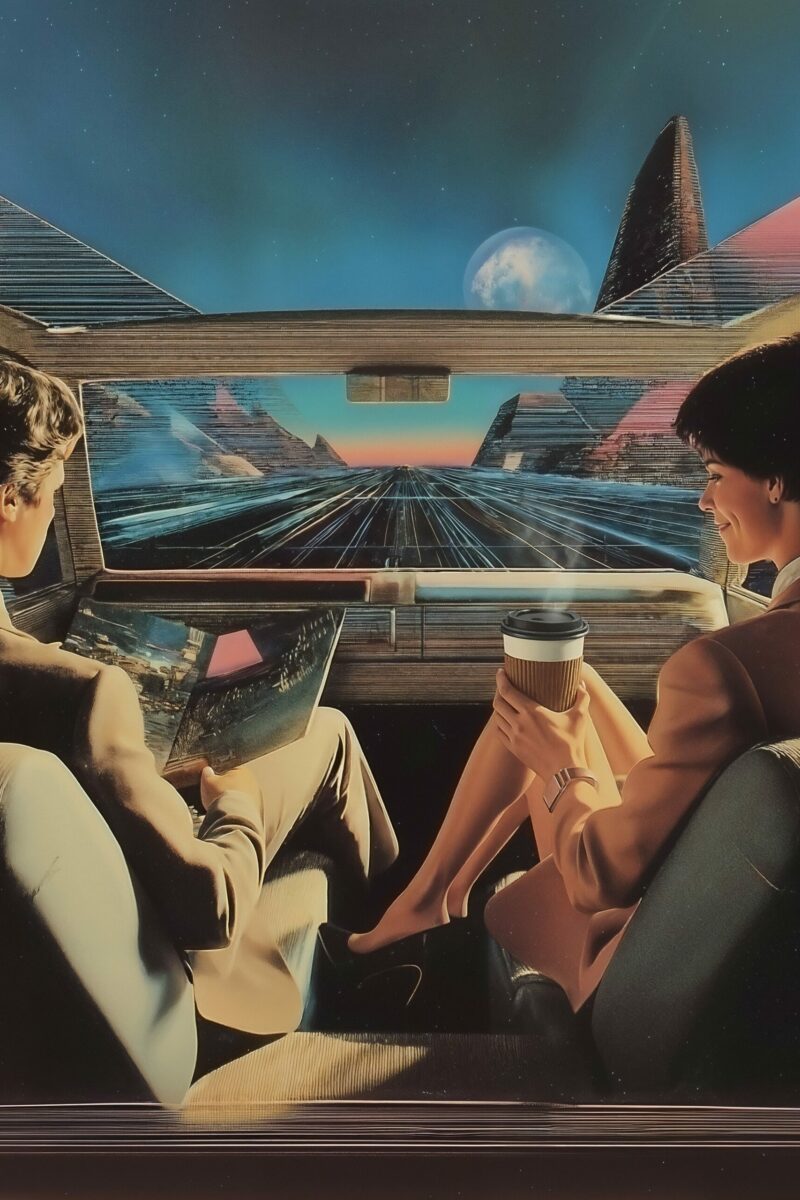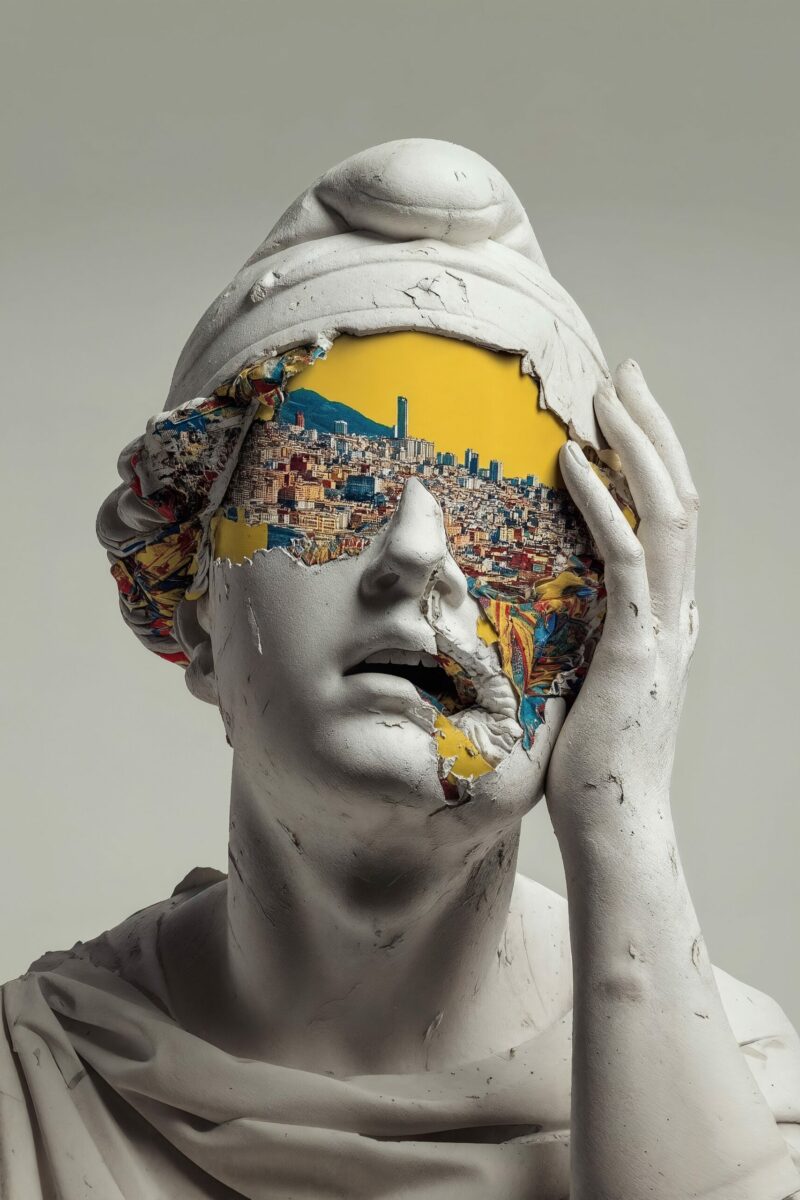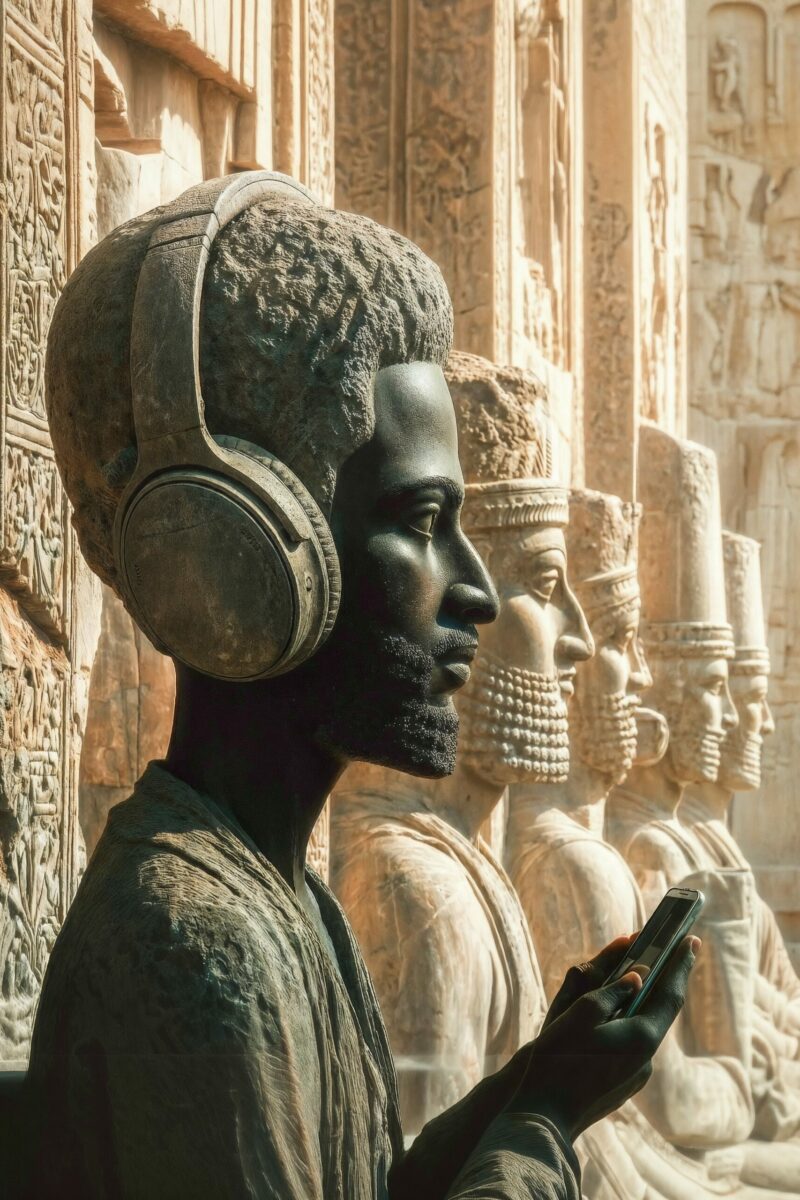Un siècle avant la Flottille pour Gaza, Joseph Kessel prenait la mer pour rejoindre la Palestine. Une expédition bien différente, qui nous éclaire sur le conflit actuel… et sur notre société du spectacle.
Avril 1926, Marseille. Joseph Kessel embarque pour Jaffa. Comme souvent, ses voyages sont nés de rencontres avec des êtres charismatiques, Monfreid, Mermoz, Kersten… Ce jour-là, l’homme qui l’accompagne se nomme Chaïm Weizmann. Difficile de trouver deux personnalités plus antagonistes. Kessel, nomade agnostique, étranger à toute ferveur religieuse, indifférent aux appels du patriotisme comme aux élans des causes collectives, est à mille lieues de l’ardeur qui étreint le futur premier chef de l’État d’Israël. Mais celui qui fait sienne la devise de Péguy, « Dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste », veut voir, et raconter.
Une terre d’espoir et de feu
Contrairement à la flottille d’aujourd’hui, il ne s’attarde pas sur sa traversée de la Méditerranée. L’important n’est pas le voyage, mais la destination. La « mer de la civilisation » s’échoue sur une terre âpre, où le feu du soleil brûle les visages et les terres, où la malaria décime les familles. Même l’eau enflamme les chairs.
Depuis 1920, la Palestine est sous mandat britannique. Une conséquence de l’effondrement de l’Empire ottoman et de sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Son territoire correspondant grosso modo aux actuelles terres d’Israël, de la Cisjordanie et de Gaza. Elle compte alors environ 600 000 Arabes et un peu plus de 150 000 Juifs. La majorité de ces derniers sont des immigrants arrivés depuis la fin du XIXᵉ siècle de Russie, de Pologne ou d’Ukraine, venus se mêler aux communautés juives autochtones présentes sur place de longue date. Les premiers sionistes, les Amants de Sion, s’étaient embarqués à la suite d’émeutes antijuives en Russie. D’autres les ont rejoints après guerre, soupçonnés d’avoir pris part à la révolution d’Octobre et pourchassés par les armées blanches, nationalistes et cosaques. Peu de temps avant que les bolcheviques, à leur tour, ne s’en prennent à eux, voyant dans le sionisme une entreprise capitaliste, bourgeoise et nationaliste. Car ce nouveau sionisme, théorisé à la fin du XIXᵉ siècle par Theodor Herzl, propose pour la première fois la création d’un foyer national pour le peuple juif, en réponse aux persécutions.
Kessel arrive dans un pays qui semble s’ébrouer après plusieurs siècles d’une vie immuable. Les fellahs, petits paysans arabes accablés de labeur et d’impôts dans un système féodal, voient les plaines se couvrir de cultures, les villes s’élever et une nouvelle liberté poindre… qui va bientôt inquiéter leurs maîtres.
Une langue, mille rêves
Comme toujours, Kessel s’intéresse davantage aux êtres qu’à la politique. Des kvoutza, ces ancêtres du kibboutz, aux communautés orthodoxes, il découvre autant de projets sionistes qu’il y a de rêves individuels. L’individu, pourtant, s’efface derrière cette espérance collectiviste qu’il a conçue en songe.
Au cœur de la vallée de Jezreel, les jeunes idéalistes socialistes qu’il rencontre ne se mettent pas en scène, ne fantasment pas leur bravoure ni l’importance de leur rôle. Non, ils sacrifient leur héritage bourgeois et leurs mains délicates pour le rude travail de la terre, creusant, récurant, construisant de l’aube au coucher du soleil. Leur sueur a transformé un inculte marécage en promesse d’abondance.
À Bnei Brak, la colonie hassidim défie la chaleur écrasante dans ses habits de ténèbres, construit des temples avant même d’avoir garanti son souper ou sécurisé ses bicoques branlantes. Aujourd’hui encore, Bnei Brak abrite le quartier le plus pauvre d’Israël, et vote à 90 % pour les ultra-orthodoxes.
À Kfar-Yeladim, Kessel découvre stupéfait une communauté d’enfants qui vit en quasi autonomie. Guidés par le pédagogue Pougatchev, ils inventent leur constitution, leur tribunal, leur système électoral et leur presse. Ils tentent de construire une société nouvelle, pour refermer la plaie ouverte par le massacre de leurs géniteurs.
Comme nulle part ailleurs, cette promesse se construit dans un chantier permanent, qui s’oppose en tout point au charme pittoresque des cités arabes patinées par les siècles. Elle porte un nom : Tel-Aviv. Un antagonisme qui illustre si bien le dilemme du progrès. Aucune nouveauté, aucune invention ne peut procurer la douceur réconfortante d’un marché, d’une échoppe ou d’un geste ancestral. Mais que vaut ce réconfort immémorial face à la malaria, à la misère du non-développement, au joug des traditions ? C’est ce carcan qui, précisément, a poussé à fonder la cité. À Jaffa, les autochtones prenaient les visages découverts des nouvelles arrivantes pour une invitation. Tel-Aviv est « née du baiser des arabes ».
De l’entrepreneur fortuné au religieux démuni ou au jeune socialiste, les aspirations sont si diverses que seule la langue peut les réunir. « Un peuple peut exister sans gouvernement choisi, sans institutions, et même sans terre qui lui appartienne. Mais s’il ne possède pas de langue qui lui soit propre, c’est un peuple mort » écrit Kessel. En Palestine, c’est la résurrection d’une langue morte qui fait naître un peuple.
Nouvelles richesses, vieilles servitudes
Depuis l’époque ottomane, les effendis sont les véritables maîtres de la société palestinienne. Propriétaires fonciers, ils accablent d’impôts les misérables fellahs qui travaillent leurs terres pour des salaires de famine. À l’arrivée des migrants, ces potentats locaux saisissent l’aubaine et leur cèdent des parcelles à prix d’or, au mépris des fellahs qui perdent leur unique moyen de subsistance.
S’ils ne sont pas acceptés dans les communautés orthodoxes ni dans les kvoutza socialistes, nombreux trouvent des emplois chez des fermiers ou des entrepreneurs juifs. À leur grande surprise, ils découvrent des ouvriers payés aux prix européens, des hommes travaillant aux champs et réclamant aisément leur dû. « Des formules étranges de liberté, d’égalité étaient dans l’air », remarque Kessel. Les effendis sentirent la colère monter chez leurs anciens vassaux.
Mais il leur restait l’influence que confère une longue domination. Ils les persuadèrent que les nouveaux venus allaient tout leur enlever et qu’il fallait les exterminer avant qu’ils ne fussent en force. La propagande réussit.
Terreur et développement
Le 4 avril 1920, 70 000 personnes se rassemblent à Jérusalem. Depuis l’hôtel de ville, le maire Moussa Qazem al-Husseini presse la foule de donner son sang pour la cause. Aref al-Aref, l’éditeur du Journal Suriya al-Janubia, harangue depuis son cheval : « Si nous n’utilisons pas la force contre les sionistes et contre les Juifs, nous n’en viendrons jamais à bout ! ». On lui répond en scandant « Indépendance ! Indépendance ! » Durant quatre jours, des combats éclatent. Malgré leur infériorité numérique, les colons résistent avec l’appui des soldats britanniques.
Ces émeutes sont la première manifestation majeure de violence entre les communautés arabe et juive de Palestine dans le contexte du conflit qui les oppose encore aujourd’hui. Elles poussent les Juifs à développer leur propre organisation de défense, la Haganah, ancêtre du noyau de l’armée israélienne : Tsahal.
Quand Kessel débarque en terre palestinienne quelques années plus tard, il sent un revirement. La dynamique de croissance qu’engendre l’immigration juive semble faire des émules. Il voit des terres sans avenir se couvrir de cultures, les grandes agglomérations devenir des centres de commerce de plus en plus florissants. Alors que le pays « nourrissait difficilement quelques centaines de milliers d’hommes » rappelle-t-il, s’ouvre la perspective d’en faire vivre des millions. Ce que, opprimés par le joug féodal de leurs maîtres, les fellahs n’ont pu faire en quatre siècles.
Le développement plutôt que l’affrontement ? En 2020 une étude indiquait que 86 % des Gazaouis se disaient plus intéressés par la croissance économique et les réformes politiques que par la politique étrangère. 7 sur 10 souhaitaient être gouvernés par l’Autorité palestinienne plutôt que par le Hamas. Organisation que les habitants des pays arabes rejetent massivement, comme le Hezbollah. Et tandis que le gouvernement Netanyahou menace d’annexer la Cisjordanie et d’occuper Gaza, près des trois quarts des Israéliens soutiennent, ou ne s’opposent pas à un accord incluant la reconnaissance d’un État de Palestine.
Kessel allait pour voir, pour sentir et pour raconter. Aujourd’hui, on va pour se montrer. Quitte à être les idiots utiles de déplorables maîtres.