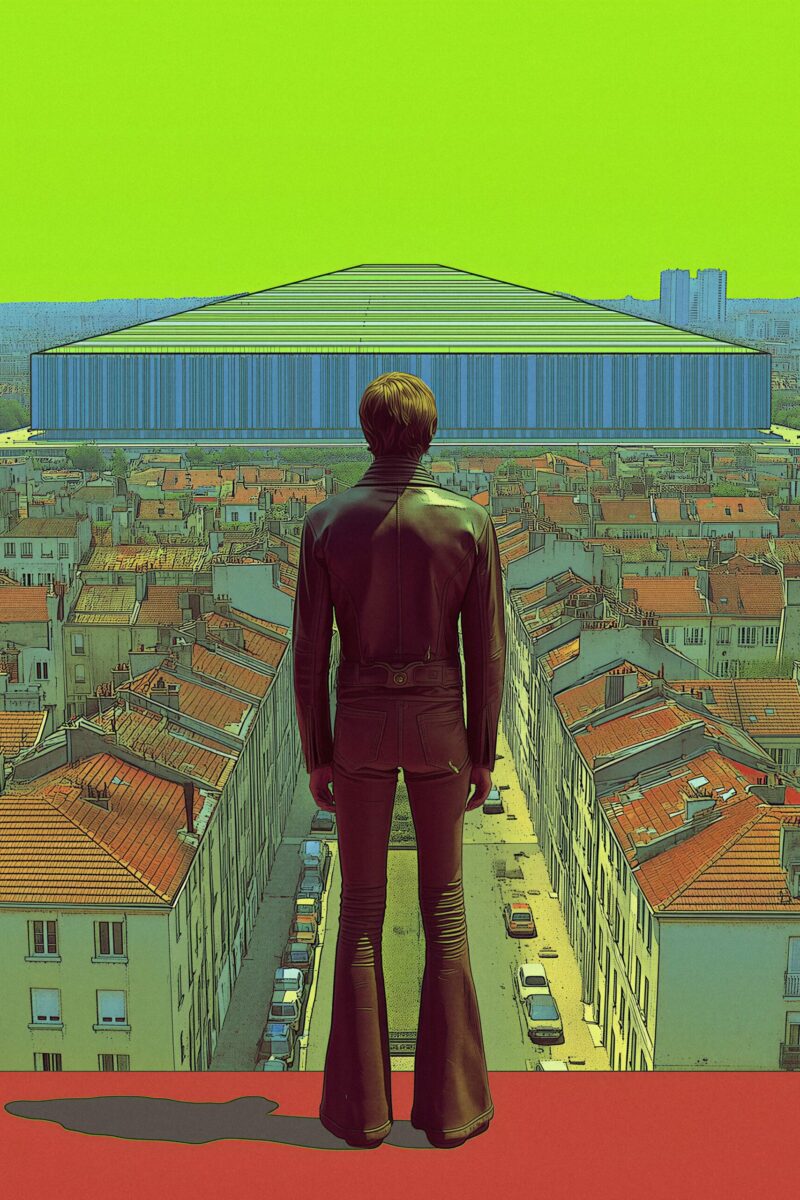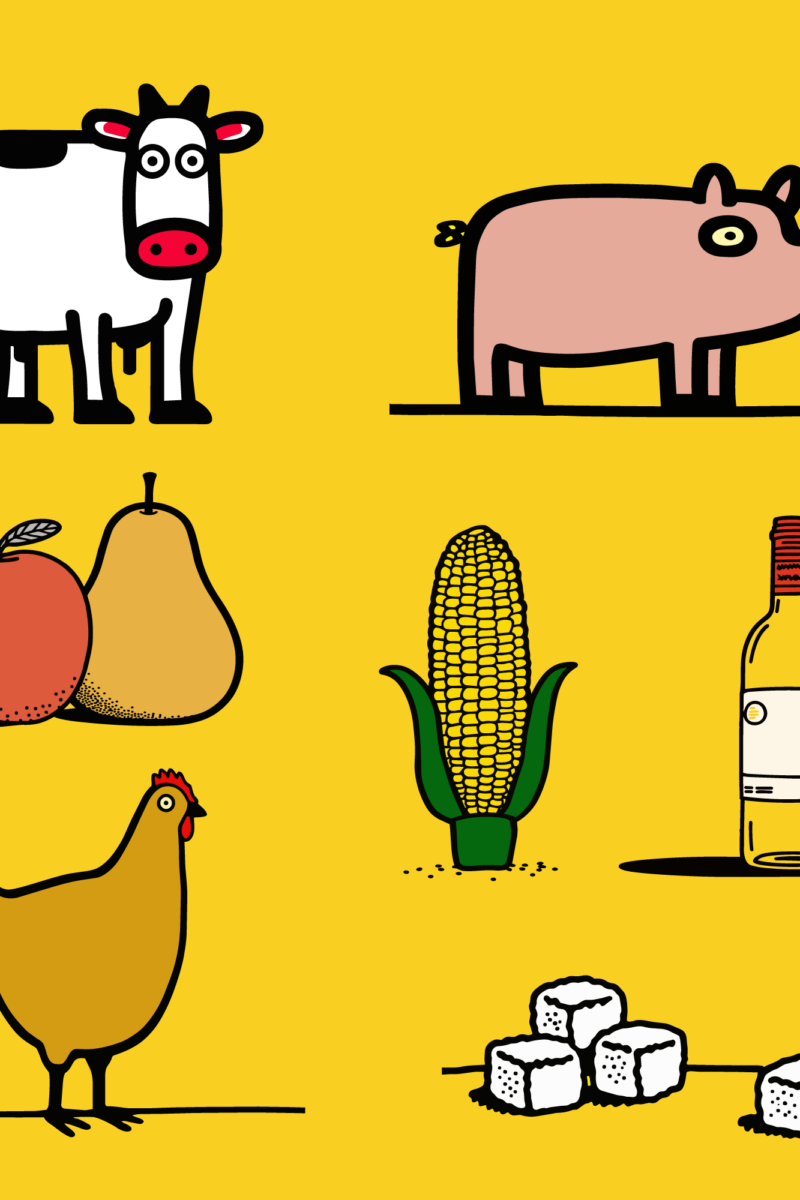De nouveaux pesticides viennent d’être interdits. Pourtant, aucune pétition ne le réclamait à cor et à cri. Aucun post Instagram, aucun article du Monde n’a crié victoire. Pourquoi ? Parce qu’ils sont « bio ». Un silence qui en dit long.
La loi Duplomb, ça vous parle certainement ? Des débats enflammés, des plateaux agités, des militants remontés, et une pétition qui a dépassé les deux millions de signatures. Tout ça pour un pesticide — l’acétamipride — que le texte voulait réhabiliter. Un pesticide pourtant autorisé par les agences sanitaires et utilisé dans le monde entier, les pays de l’UE en tête. Difficile à remplacer dans certaines filières, comme celles regardant la betterave ou la noisette, son interdiction fait planer la menace de fortes baisses de rendement, voire de la disparition pure et simple de ces productions dans notre pays.
Lorsqu’il a été banni, les acteurs de l’écologie politique ont laissé éclater leur joie. Même enthousiasme lorsque le Conseil constitutionnel a retoqué sa réintroduction, en août dernier. Mais alors que toute l’attention se concentrait sur cet épisode hautement polémique, l’Anses — l’agence chargée d’évaluer les risques liés aux produits phytosanitaires — se penchait, elle, sur un tout autre dossier. Un dossier bien moins brûlant, mais porteur d’un enjeu environnemental tout aussi majeur : celui du cuivre.
Des substances stratégiques en bio
Le cuivre, c’est un vieil allié de l’agriculture. Un élément chimique capable de tuer à peu près tout ce qui vit à l’échelle microscopique. À bonne dose, il altère les membranes cellulaires, provoque la libération de radicaux libres meurtriers et inhibe certaines enzymes. Autant d’actions qui en font un biocide redoutable, notamment contre les champignons et les bactéries. Ces propriétés le désignent comme une arme de choix contre le mildiou, ce fléau des pommes de terre, des cultures maraîchères… et surtout de la vigne.
Sans traitement, la maladie fongique peut ravager une récolte entière et occasionner jusqu’à 100 % de pertes. Les pesticides cupriques — dans lesquels le cuivre est souvent associé à des sulfates ou à des hydroxydes — agissent en détruisant les spores du champignon, empêchant ainsi toute propagation. Ils ne soignent pas le mildiou, car le cuivre ne pénètre pas les tissus végétaux, mais ils le contiennent efficacement. Une sorte de bouclier préventif.
Est-ce grâce à leurs performances, ou simplement parce qu’ils ont plus d’un siècle d’histoire derrière eux, avec la célèbre bouillie bordelaise, qu’ils étaient autorisés dans l’agriculture biologique ? Ils sont pourtant les fruits de procédés industriels et difficilement qualifiables de « naturels ». Une licence qui pouvait étonner, mais hautement stratégique.
Car des alternatives existent. Certaines molécules issues de la chimie de synthèse sont même plus efficaces et beaucoup plus ciblées. Elles agissent sur des enzymes fongiques précises et permettent de réduire drastiquement, voire d’éliminer, l’usage du cuivre. Mais, on l’aura compris, elles ont un défaut rédhibitoire, celui de ne pas être… bios.
En 2018, l’INRA s’est d’ailleurs posé la question : peut-on se passer du cuivre en agriculture biologique ? La réponse fut sans surprise : difficilement. Les solutions agronomiques — meilleure aération du feuillage et élimination des résidus contaminés — sont lourdes à mettre en œuvre et rarement suffisantes. Les produits « naturels » (huiles essentielles, extraits de plantes, stimulateurs de défenses immunitaires) n’atteignent pas encore l’efficacité espérée.
Et la piste de l’amélioration variétale piétine : refus du génie génétique, contraintes des AOC, cépages imposés, exigences de goût… Les freins sont multiples. En somme, à l’instar de l’acétamipride pour la betterave ou la noisette, les pesticides à base de cuivre demeurent, pour la viticulture biologique, tout simplement incontournables.
Bio, mais pas écolo
Incontournables, oui. Mais loin d’être anodins. Car si les pesticides à base de cuivre sont autorisés en agriculture biologique, cela ne veut pas dire qu’ils sont sans risques, ni pour la santé, ni pour l’environnement. Côté santé, la bonne nouvelle, c’est que le cuivre ne s’infiltre pas dans les tissus végétaux. Le consommateur est donc a priori épargné. En revanche, pour ceux qui manipulent ou épandent ces produits, c’est une autre histoire. L’exposition directe répétée peut provoquer à terme des troubles digestifs, des atteintes hépatiques (stéatose, cirrhose) et, en cas de fortes doses, des effets pulmonaires, neurologiques ou sanguins. Pas de cancérogénicité détectée ici, mais une toxicité bien réelle en cas d’exposition chronique, surtout en l’absence d’équipements de protection.
Sur le plan environnemental, le bilan n’est pas plus flatteur. Le cuivre, rappelons-le, est un biocide à large spectre : il ne choisit pas ses cibles. Ce qui fait sa force contre les micro-organismes pathogènes en fait aussi une arme aveugle, capable de nuire sans distinction à tout un écosystème. Dans les sols, il décime les micro-organismes utiles. Et dans les rivières, il peut affecter la faune aquatique lorsqu’il est entraîné par le ruissellement ou l’érosion. De plus, leur emploi préventif conduit souvent à des traitements systématiques, sans réelle prise en compte du niveau de contamination, contrairement aux produits de synthèse, dont l’action plus ciblée et curative permet de n’intervenir qu’en cas de nécessité.
Mais le plus gros problème, c’est sa persistance. Contrairement aux fongicides organiques modernes ou à des molécules comme l’acétamipride, biodégradables par nature, le cuivre est un élément chimique : il ne disparaît pas comme ça. Sous forme d’ion Cu²⁺, il se fixe solidement aux particules du sol, piégé par les complexes argilo-humiques chargés négativement. Ainsi, il ne se lessive pas, il s’accumule.
Et cette accumulation n’a rien d’anecdotique : dans les sols viticoles, les concentrations de cuivre sont généralement 5 à 20 fois supérieures à la normale. À long terme, ces niveaux deviennent toxiques, non seulement pour les vers de terre et les micro-organismes, mais aussi pour les plantes elles-mêmes. Le cuivre finit donc par freiner la croissance des cultures… et menace la fertilité des sols qu’il était censé protéger.
L’épée de Damoclès
Pour ces raisons, depuis 2018, le cuivre figure sur la liste européenne des « substances candidates à la substitution ». Toléré, mais sous surveillance. Et dès qu’une alternative crédible émerge ou que les risques apparaissent trop importants, les autorisations de mise sur le marché (AMM) peuvent sauter.
C’est précisément ce qui s’est produit à l’été 2025. Alors que la France s’écharpait sur la possible réintroduction de l’acétamipride, l’Anses, de son côté, tranchait : lors du réexamen septennal, elle a drastiquement restreint l’usage des pesticides cupriques. Désormais, la plupart sont interdits, notamment les formulations à base de poudre mouillable, jugées trop risquées pour les utilisateurs. Pour la vigne, seuls deux produits ont conservé leur AMM, assortis de limites strictes sur les doses et les fréquences d’épandage.
Et tandis que la censure de la réhabilitation de l’acétamipride déclenchait l’euphorie des milieux militants, les mesures strictes prises contre le cuivre ne suscitaient quant à elles que silence et indifférence. Le camp écologiste, d’habitude si prompt à s’enflammer sur la question des pesticides, est resté muet.
Les réactions sont donc venues d’ailleurs. Du côté de la filière bio, d’abord. Pour ceux qui s’étaient réjouis de l’interdiction de l’acétamipride, c’est la douche froide. Il leur reste bien deux produits cupriques pour sauver les récoltes… mais pour combien de temps ?
Et puis, il y a la « Task Force cuivre » qui a déposé un recours gracieux contre l’Anses — un consortium d’entreprises du secteur, créé pour défendre l’usage du cuivre et tenter de prolonger son autorisation en Europe. Bref, un lobby. Mais un lobby bio, alors tout va bien.
Moralité
La première leçon de cette affaire ? L’écologie politique a ses priorités : protéger le bio semble passer avant la lutte contre les pesticides réellement problématiques. Et il est d’ailleurs assez cocasse de constater que les lobbys en lien avec le bio, comme cette fameuse « Task Force cuivre » peuvent mettre publiquement la pression sur les agences, sans jamais subir les foudres des militants. Une situation qu’on aurait du mal à imaginer dans le cadre de la loi Duplomb.
Deuxième enseignement : le bio n’est pas forcément synonyme d’absence d’impact. Cette affaire met en lumière une incohérence du label : privilégier des substances « naturelles », même quand elles sont pires que leurs équivalents synthétiques. Résultat : des situations où l’on se retrouve coincé, sans alternatives viables.
Et enfin, la dernière leçon : l’agriculture avance, même sans pétitions, campagnes médiatiques ou décisions politiques démagogiques. Les agences sanitaires peuvent trancher sur des bases scientifiques, dans l’intérêt commun. Les pesticides les plus problématiques sont déjà interdits — c’est le cas de la majorité des substances CMR1 (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques avérées). Et avec le temps, de plus en plus de substances dangereuses sont remplacées par des produits moins nocifs.
En bref, pendant que les débats font le buzz, la science, elle, continue de faire le ménage.