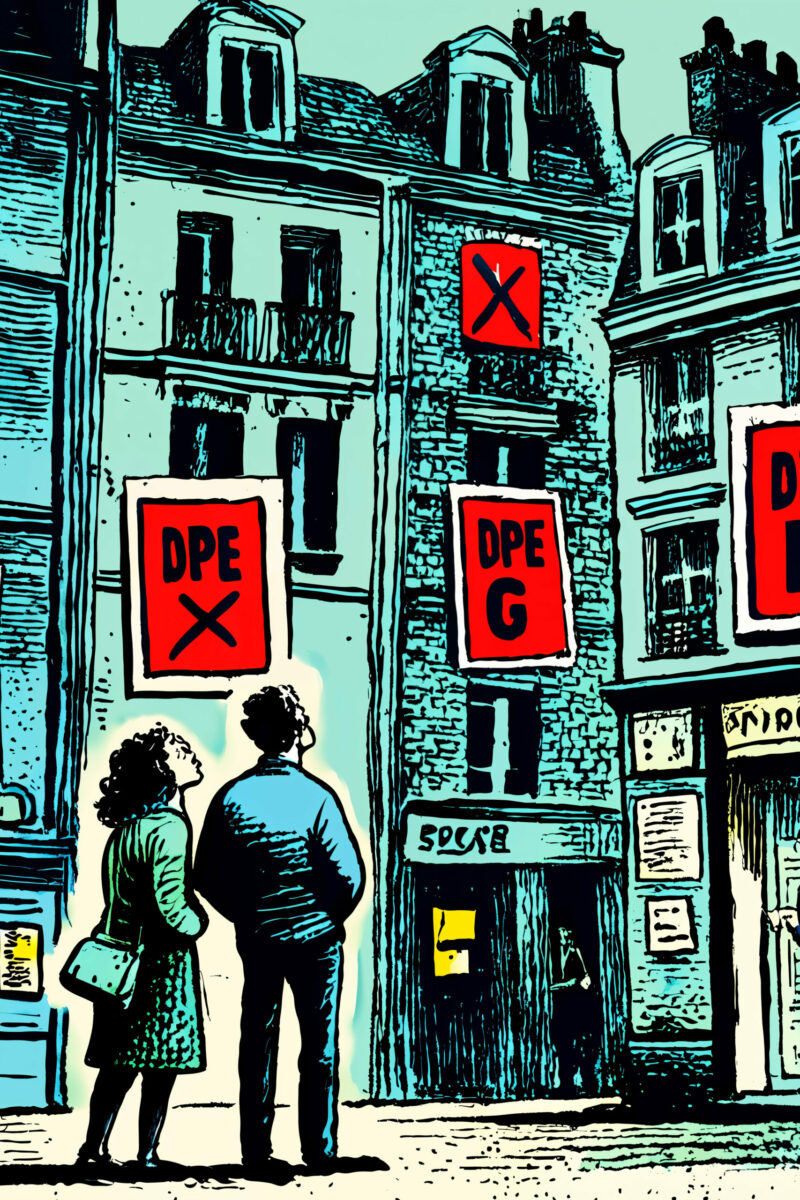Pensée en contradiction avec la réalité du changement climatique et du développement du télétravail, la RE2020 illustre les travers normatifs français. En voulant réduire l’impact énergétique et climatique des bâtiments, elle pourrait rendre nos logements… invivables.
La Réglementation environnementale 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, s’applique à toutes les constructions neuves, en remplacement d’une autre norme, la RT2012. Son ambition est triple : diminuer la consommation d’énergie primaire (soit celle consommée par nos équipements), prendre en compte les émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments et garantir un niveau acceptable de confort intérieur en période estivale, dans le contexte du réchauffement climatique. Présentée comme l’un des cadres réglementaires les plus exigeants au monde, cette RE2020 concerne un pan colossal de l’économie. En 2023, la construction neuve représentait près de la moitié du chiffre d’affaires du bâtiment, soit environ 100 milliards d’euros sur les 215 que pèse le secteur.
Contrairement à une loi débattue et votée au Parlement, la RE2020 n’est pas un texte législatif, mais un règlement technique, élaboré sous forme de décret et d’arrêtés. C’est une nuance essentielle, d’abord parce que le pouvoir réglementaire dépend du gouvernement, contrairement au pouvoir législatif, ensuite parce qu’elle repose sur une immense mécanique administrative peu lisible pour le grand public comme pour les élus. À elle seule, la documentation du moteur de calcul thermique – qui sert de base à l’évaluation de conformité – dépasse les 1800 pages. Ce sont ces modèles, d’une extrême précision, qui déterminent si un bâtiment respecte ou non la réglementation. Or, dans un tel système, le moindre paramètre peut faire basculer un projet du bon ou du mauvais côté de la norme.
Une norme déjà obsolète…
Parmi les nouveautés introduites, l’indicateur de confort d’été est l’un des plus discutés. Il mesure, pour chaque logement, le nombre d’heures durant lesquelles la température intérieure dépasse les 26 °C, pondérées en fonction de l’intensité de ce dépassement. Les seuils de tolérance varient selon les zones géographiques, l’orientation des logements et leur configuration (traversante ou non). Le choix du terme « confort d’été » est toutefois trompeur. Il laisse entendre qu’il s’agit d’un simple agrément, alors qu’il est en réalité question d’un enjeu vital face à des canicules qui deviennent plus longues, plus fréquentes et plus sévères. Derrière cette appellation presque légère se cache tout simplement la question centrale de l’habitabilité des logements.
Loi contre les « bouilloires thermiques » : demain, attaquer son propriétaire alors qu’on a la clim ?
J’approfondisPour modéliser ce confort d’été, la RE2020 utilise des jeux de données météorologiques couvrant la période 2000-2018, auxquels est ajoutée une seule séquence de canicule basée sur le terrible épisode d’août 2003. Cette approche statistique est déjà en décalage avec la réalité actuelle, et encore plus avec celle qui s’annonce dans le futur. Autre biais majeur : le scénario de vie sur lequel repose la simulation. Par convention, un logement est supposé être inoccupé de 10 h à 18 h, au moins pendant quatre jours chaque semaine, comme le mercredi après-midi, et fermé durant une semaine en décembre. Seules les heures dites « d’occupation » sont prises en compte dans le calcul. En d’autres termes, si la température dépasse les seuils en journée, mais que le logement est censé être vide, cela n’a aucun impact sur l’indicateur. Cette hypothèse, acceptable il y a dix ans, est aujourd’hui largement obsolète. Avec l’essor considérable du télétravail introduit par la pandémie de Covid – qui concerne près d’un salarié sur cinq –, sans compter les retraités, les étudiants ou les jeunes enfants, un grand nombre de logements sont désormais occupés en permanence, donc aussi aux moments où la chaleur devient la plus difficile à supporter.
…qui diabolise la clim
Un autre point de friction se situe dans la manière dont la RE2020 traite la climatisation. Spoiler : très mal. En théorie, cette réglementation ne l’interdit pas. En pratique, elle la dissuade fortement. Le cœur du problème réside dans le mode de calcul du besoin bioclimatique, ou Bbio, un indice théorique qui agrège les déperditions thermiques, les apports solaires et les besoins d’éclairage. Depuis l’entrée en vigueur de la RE2020, le seuil de ce Bbio a été abaissé d’environ 30 %. Pour rester dans les clous, les constructeurs sont donc incités à renforcer l’isolation, optimiser l’orientation, limiter les surfaces vitrées exposées… Jusque-là, tout va bien. Mais il sont surtout contraints de ne pas déclarer de système de refroidissement, si jamais ils en ont implanté un. Car déclarer une climatisation devient très pénalisant. Le logiciel de calcul considère alors que le logement devra maintenir une température de 26 °C en continu, jour et nuit, en supprimant toute forme de rafraîchissement naturel, comme la ventilation nocturne ou l’ouverture des fenêtres.
Pour compenser cette consommation mécanique, il faut alourdir considérablement les performances de l’enveloppe thermique, ce qui entraîne une hausse significative des coûts. Résultat : nombre de promoteurs ou constructeurs font le choix de ne pas déclarer de système de froid dans les documents, même si celui-ci est prévu ou facilement activable. Dans les logements collectifs, notamment sociaux, cela peut se traduire par une désactivation complète du mode froid. Dans certains cas, on n’installe même pas le module de réversibilité sur les pompes à chaleur, alors même qu’il pourrait s’avérer salvateur en période de forte chaleur.
Ce paradoxe réglementaire amène à une situation absurde où l’on interdit de fait aux habitants d’utiliser la fonction de rafraîchissement de leur équipement sur l’autel de la conformité énergétique. Or, si les pompes à chaleur, en particulier les modèles air-eau, ne sont pas très efficaces pour produire du froid, elles le font à un coût carbone relativement modeste. De plus, les nouveaux fluides frigorigènes utilisés sont bien moins nocifs pour le climat que les anciens. Le propane (R290), par exemple, a un potentiel de réchauffement global de 3, contre plus de 2000 pour certains fluides encore en usage il y a peu.
Jeter de l’énergie décarbonée plutôt que rafraîchir
Autre verrou : le coefficient de conversion de l’électricité dans le calcul de l’énergie primaire. Aujourd’hui, l’électricité utilisée pour produire du froid est pénalisée par un coefficient de 2,3, pour 1 kWh réellement consommé. Ce taux est censé refléter la consommation d’énergie nécessaire à sa production. Pertinent pour comparer les sources d’énergie pour le chauffage, il n’a pas beaucoup de sens dans le contexte du rafraîchissement, avec une électricité décarbonée. En 2024, l’intensité carbone moyenne de l’électricité française était de 21,3 g de CO₂ par kilowattheure, contre 64 g retenus officiellement dans les calculs pour le froid par notre règlement. En été, cette intensité est encore plus faible, descendant à 15 g/kWh sur les mois de juillet et août. Le réseau connaît même des périodes d’excédent de production, avec des heures où les prix deviennent négatifs, ce qui signifie que de l’électricité est perdue faute de demande. On a ainsi jeté, au sens énergétique du terme, environ 1,7 térawattheure de production renouvelable en 2024, soit presque trois fois plus qu’en 2023.
Enfin, reste la question des effets de la climatisation sur les îlots de chaleur urbains. Il est vrai que les unités extérieures peuvent réchauffer l’air ambiant, notamment dans les centres-villes denses comme Paris, où la température nocturne à deux mètres du sol peut augmenter de deux degrés. Mais cet effet est bien moindre dans les zones pavillonnaires ou peu denses, qui concentrent aujourd’hui la majorité des constructions neuves. Et il peut être atténué par des choix d’implantation, en installant les unités sur les toits plutôt qu’en façade, afin de favoriser la dissipation de chaleur en hauteur.
Ce que révèle l’ensemble de ces paradoxes, c’est un décalage croissant entre la logique réglementaire et la réalité climatique. Alors que les canicules se multiplient et s’intensifient, la RE2020, en voulant bien faire, risque de produire des logements théoriquement performants mais pratiquement invivables en été. Car, on l’a vu, refroidir passivement un logement est tout simplement impossible. Un aveuglement absurde, et même dangereux : depuis le début du XXIe siècle, les canicules ont fait 32 000 morts en France.