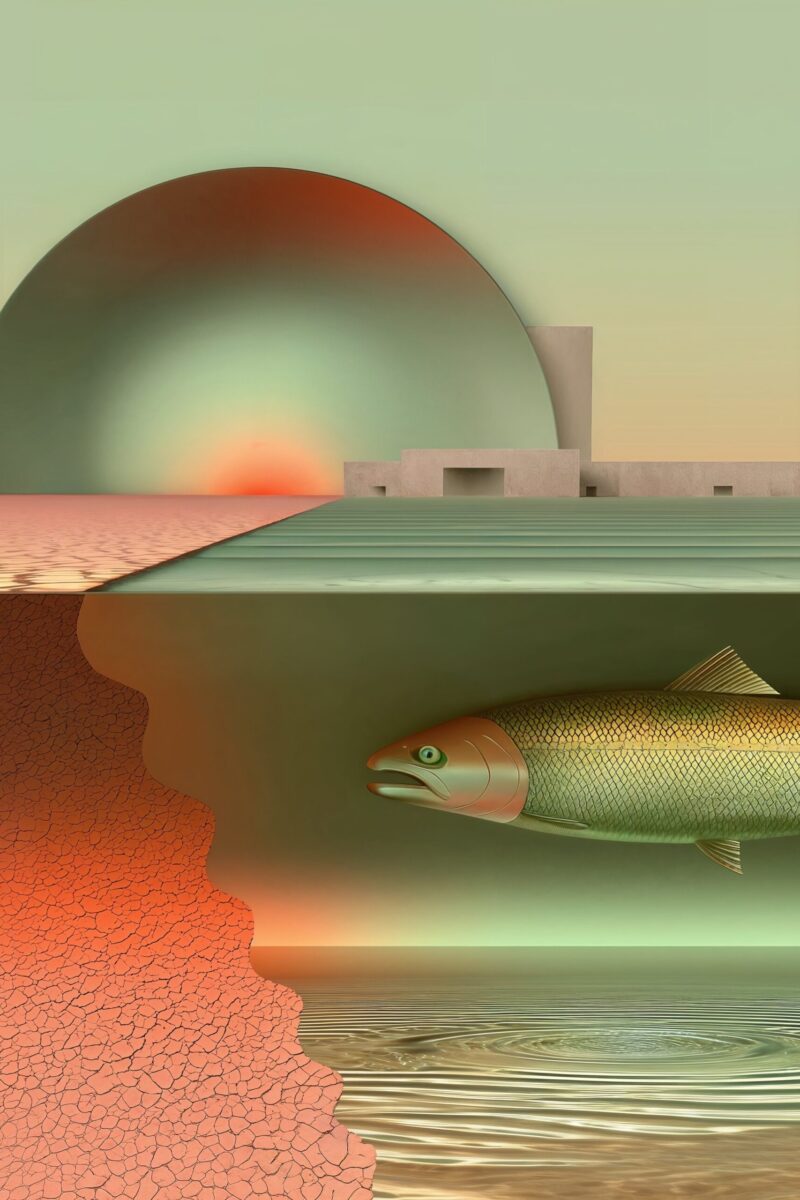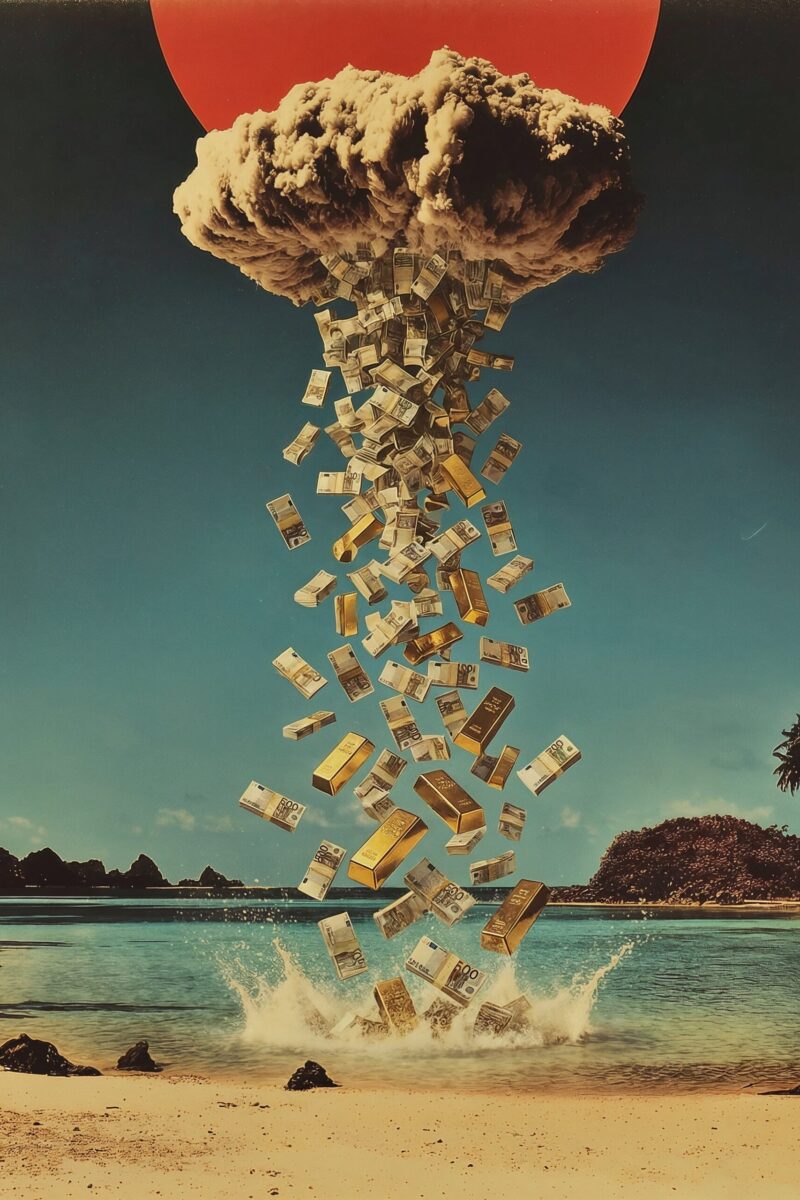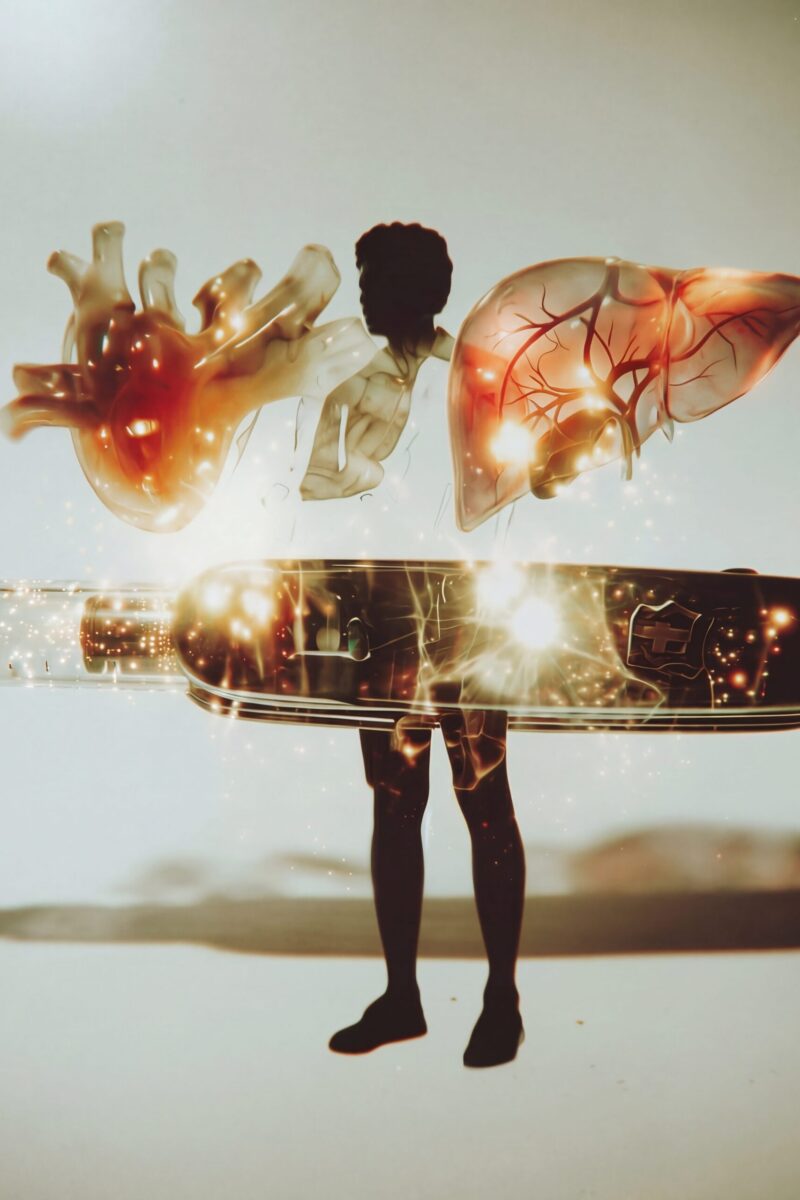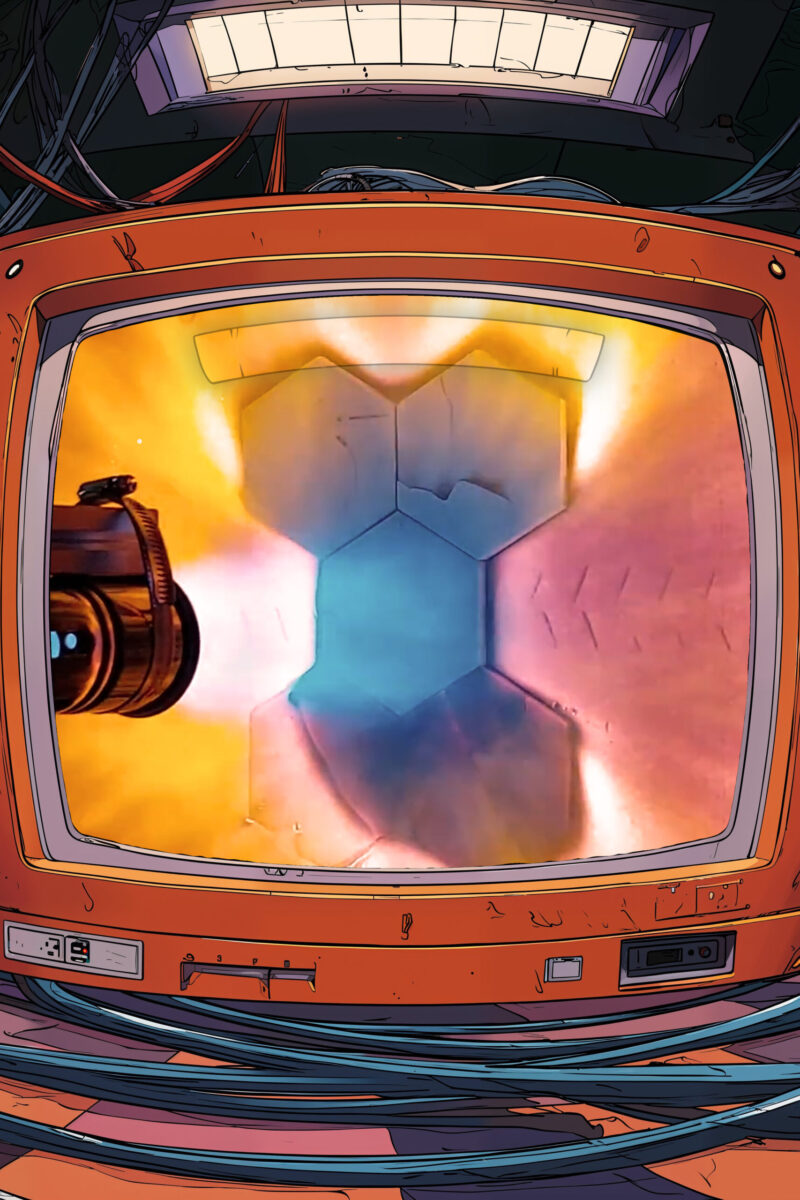Le 4 Février dernier, j’apprends qu’une pétition réclame l’interdiction de l’Aspartame. Pas du tabac, ni de l’alcool, non, de l’Aspartame. La très respectable Ligue Contre le Cancer soutient cette initiative de l’ONG Foodwatch et de l’application Yuka. L’Aspartame, vraiment ?
Les procureurs médiatiques l’accusent d’être à l’origine de cancers évitables, notamment chez les jeunes, risque jugé « inacceptable ». Pourquoi donc cette information est-elle arrivée ce jour-là sur mon chemin ? Parce qu’il s’agissait de la Journée mondiale contre le cancer. Enfin, visiblement surtout de la Journée mondiale contre l’aspartame, étant donné qu’elle a monopolisé 90% de la fenêtre médiatique dédiée au sujet. Ni le tabac, ni l’alcool, ni les papillomavirus, ni l’obésité croissante dans les pays développés, notamment chez les enfants, tous facteurs de risque établis de cancer, n’auront eu droit à la même exposition médiatique. Une fois encore, l’attention aura déviée des vrais enjeux de santé publique au profit d’un épouvantail à fort potentiel anxiogène : j’empoisonnerais donc, père indigne, à petit feu mes enfants en leur autorisant de boire un soda « light » occasionnellement ? Je commençais tout doucement mais sûrement à m’agacer et décidais donc de creuser un peu plus cette histoire.
Un pétard mouillé scientifique ?
Rapidement, je réalise que tout ceci ne repose… que sur une seule étude. Publiée en 2022, cette publication rapporte une hausse du risque de cancer de 13 % chez les gros consommateurs d’aspartame. Dit comme ça, ça impressionne. Mais dans le jargon des épidémiologistes, cela signifie un risque relatif de 1,13. Autant dire un murmure statistique. Pour mémoire, le tabac multiplie par 25 (soit 2500 % !!!) le risque de cancer du poumon. À titre de comparaison, pour un risque du même ordre de grandeur et mieux établi, l’utilisation prolongée de la pilule contraceptive est associée à un risque relatif de 1,2 pour le cancer du sein, et pourtant, elle reste largement prescrite en raison de ses bénéfices. Non, ce jour-là, c’est l’aspartame qui a eu droit à sa mise au pilori publique.

Or, aucune donnée solide ne vient vraiment soutenir les conclusions alarmistes de l’étude NutriNet-Santé. On est face à un pétard mouillé scientifique, bien relayé médiatiquement. Une méta-analyse récente, qui compile plusieurs études sérieuses, n’a trouvé aucun lien significatif entre édulcorants artificiels (dont l’aspartame) et cancers. Rien. Nada. Mieux encore, une étude espagnole multicentrique (MCC-Spain) non seulement n’établit aucun lien, mais elle a même observé un effet protecteur contre le cancer du sein chez les gros consommateurs : –72 % de risque. Soyons justes : cette même étude note une légère hausse du risque de cancer gastrique, preuve que les données sont nuancées, parfois contradictoires. Bref, la science ne crie pas au scandale. Elle doute. Et c’est tout son intérêt.
Aspartame, pesticides, même combat ?
Même mécanique avec les pesticides. Une étude épidémiologique écologique française a récemment suggéré une augmentation de 1,3 % du risque de cancer du pancréas pour chaque hausse de 2,63 kg/ha dans l’achat de certains pesticides d’un territoire, sur la base de plus de 130 000 cas recensés entre 2011 et 2021. Il n’en fallait pas plus pour que certains y voient aussitôt la clé de l’augmentation (réelle, certes, mais modérée) de l’incidence de ce cancer. L’équation était toute trouvée : pesticides = cancer du pancréas = panique générale. Sauf qu’évidemment, personne n’a pris le temps de préciser que cette augmentation de risque – si elle est avérée – reste extrêmement limitée. Surtout quand on la compare aux niveaux moyens d’usage des pesticides en Europe : 3,45 kg/ha en France, contre 4,69 kg/ha en Italie et 4,06 kg/ha en Allemagne. Rien qui permette de crier à l’empoisonnement massif des champs hexagonaux. Mais le plus ironique reste à venir : les agriculteurs eux-mêmes – ceux qui manipulent ces produits à longueur d’année – présentent un taux plus faible de cancer du pancréas que la population générale. Un comble. Et ce, probablement parce qu’ils fument moins et ont une prévalence plus basse d’obésité. Alors, peut-être qu’avant d’incriminer la chimie des champs, il serait temps de regarder ce qu’on met dans nos assiettes… et dans nos poumons.

Attention, il ne s’agit pas de nier les risques environnementaux. L’affaire de la chlordécone aux Antilles – ce pesticide massivement utilisé entre 1970 et 1990 contre le charançon du bananier – rappelle à quel point certaines expositions chimiques peuvent être graves et durables. Mais tout ne peut pas être mis dans le même sac au nom d’un principe de précaution poussé à l’extrême, qui néglige parfois les effets pervers de ses propres injonctions. Restreindre l’aspartame sans solution crédible ? On favorise le retour du sucre, dont les ravages sur la santé sont bien établis. Discréditer les pesticides sans voir les enjeux agricoles et sanitaires globaux ? On fragilise des équilibres déjà précaires et risque d’encourager des alternatives pires ou de décourager des pratiques vertueuses. La peur n’est pas une stratégie de santé publique.
Refusons la politisation du cancer
Dans ce climat de suspicion généralisée, certains journalistes vont plus loin. Avec, comme souvent, en tête de gondole, Stéphane Foucart, dans une tribune récemment parue dans le Monde. Il y évoque un possible lien entre la survenue d’un cancer chez une jeune femme et… son vote (sic). Oui, vous avez bien lu. La science, la vraie, quoi ! Face à la maladie, écrit-il, il faudrait se demander « pour qui on a voté ». Ce glissement vers une politisation du cancer est non seulement indécent mais dangereux. En désignant des ennemis politiques plutôt que des causes biologiques ou comportementales, on détourne le débat de sa rigueur scientifique. On alimente la méfiance envers la médecine et la politique au lieu de construire des solutions partagées.
De même, on a vite fait de créer la panique en parlant de « tsunami » de cancers chez les jeunes, alors que les chiffres sont simplement mal interprétés (voir encart). Une population plus nombreuse et mieux diagnostiquée entraîne mécaniquement plus de cas. D’où l’importance des taux standardisés : ils ajustent selon l’âge et permettent de distinguer croissance démographique et véritables facteurs de risque. Ainsi, l’incidence paraît plus élevée en Afrique (16,2 %) qu’en Europe (3,6 %) chez les 15–39 ans, principalement à cause d’une population plus jeune. L’absence de vaccination (HPV, hépatite B), de dépistage et l’accès limité aux soins expliquent aussi une mortalité bien plus élevée.
Pendant qu’on consacre une journée entière à débattre de l’aspartame, dans une mécanique fondée sur la peur et sans mise en perspective, les données les plus solides passent à la trappe. Or, le taux de mortalité par cancer baisse régulièrement depuis 1990 : –1,8 % par an chez les hommes, –0,8 % chez les femmes. Chez les moins de 50 ans, la mortalité a même chuté de plus de moitié. Ces progrès tiennent au dépistage, aux innovations thérapeutiques, à un meilleur accès aux soins… et à la baisse du tabac et de l’alcool, surtout chez les hommes. Car 40 % des cancers sont évitables ! Voilà ce qu’il faudrait marteler. Le tabac tue prématurément 75 000 personnes chaque année (soit une ville comme Antibes), l’alcool 16 000. L’obésité, la sédentarité, les infections à HPV ou à l’hépatite B sont des leviers d’action majeurs.
En cancérologie, l’espoir n’est désormais plus un vain mot. Il se vit. Julie, 34 ans, a repris sa vie après un mélanome métastatique et a mis au monde un petit Lucas qui se porte comme un charme, grâce à l’immunothérapie – voir encart – qui a complètement et durablement effacé les métastases de son corps. Maurice, 68 ans, a retrouvé les promenades familiales après une thérapie CAR-T qui a éradiqué son lymphome résistant à la chimiothérapie. Ces parcours, fruits d’une médecine exigeante et fondée sur des preuves, sont la véritable réponse à la peur. Mais ils peinent à émerger dans un espace médiatique saturé de récits anxiogènes.
Il est temps de reprendre la main. De cesser de courir après des causes invisibles et de se concentrer sur les priorités réelles. La prévention, ce n’est pas diaboliser l’alimentation industrielle ou le shampoing du quotidien. C’est promouvoir le sevrage tabagique, la vaccination, l’activité physique et la lutte contre l’obésité, comme l’accès aux soins. C’est aussi refuser que l’on instrumentalise le cancer pour faire passer des messages politiques ou moralisateurs. Car oui, effectivement, derrière, il y a potentiellement de mauvaises décisions politiques.
La science progresse. Les malades en bénéficient. Aidons-les à guérir, non en désignant des boucs émissaires douteux, mais en renforçant ce qui marche. La peur ne sauve pas. La rigueur, si.
Aucun lien d’intérêt rapporté