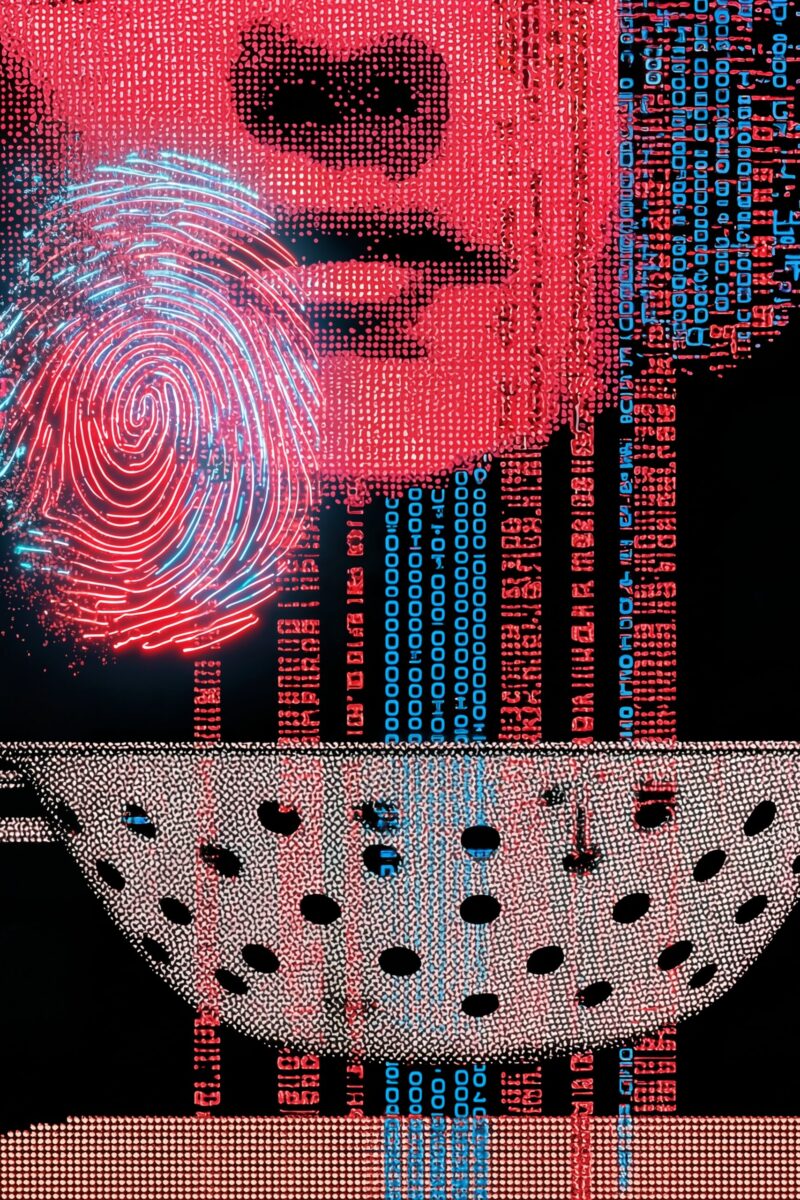En dix ans, le PIB du Venezuela a été divisé par cinq — un effondrement supérieur à celui d’un pays en guerre. Près d’un quart de la population a fui la misère et la répression. Chute des prix du pétrole ? Sanctions américaines ? Les causes, plus profondes, prennent racine dans les fondements mêmes du chavisme.
Depuis plus de dix ans, le Venezuela s’est enfoncé dans une crise sans précédent. La population manque de tout : ruptures d’approvisionnement, services publics en ruine, salaires qui ne couvrent plus l’essentiel, familles éclatées par la nécessité.
L’argent facile du pétrole
Pourtant, le pays repose sur l’un des sous-sols les plus riches du monde. Bien avant Hugo Chávez, le Venezuela était déjà un État rentier : plus de 90 % de ses exportations provenaient du pétrole, tandis que l’industrie, l’agriculture et les secteurs non pétroliers étaient marginalisés. Lorsqu’il arrive au pouvoir, le baril se négocie autour de 10 dollars. Il grimpera jusqu’à 130 dollars sous sa présidence. Cette manne exceptionnelle transforme la rente pétrolière en système clientéliste : les revenus financent programmes sociaux et emplois publics, distribués en échange de l’allégeance au régime.
La loyauté remplace la compétence, le parti remplace l’administration, l’urgence remplace l’investissement. Le socialisme populiste n’administre pas seulement l’économie, il organise la dépendance.
La compagnie pétrolière publique PDVSA est devenue le symbole le plus parlant de cette transformation. En 2017, elle comptait 115 000 salariés, quatre fois plus qu’avant l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chávez, tout en produisant quatre fois moins de pétrole. Les licenciements massifs de 2002 – 19 000 des 30 000 salariés du groupe – ont laissé des traces. Gouverner selon les besoins des amis s’est fait au détriment de la compétence technique et de l’avenir de la nation.
Si les largesses du pouvoir profitent dans un premier temps aux classes populaires, l’effondrement du prix du baril – 30 dollars en 2015 – fait s’écrouler tout le système comme un château de cartes. Sans épargne de précaution, sans fonds souverain crédible, sans accès normal aux marchés financiers, c’est un choc cataclysmique. Les autres pays pétroliers ajustent, puisent dans leurs réserves. Le Venezuela se contente d’imprimer de la monnaie.
Mais la chute des cours n’est pas la seule raison de la destruction de l’économie du pays. Celle-ci a commencé bien plus tôt.
Les racines du mal
En 2002, seulement quatre ans après son arrivée au pouvoir, Hugo Chávez fait face à une grève générale et à un conflit ouvert avec le secteur privé. La corruption, les expropriations arbitraires, les nationalisations sans compensation et la subordination de la justice au pouvoir politique ont entraîné une perte de confiance des entrepreneurs et des investisseurs.
Le président vénézuélien prend alors deux décisions politiques qui ont un impact économique majeur : le contrôle des prix et le contrôle des changes.
Parmi les produits concernés figure un pilier de l’alimentation vénézuélienne : la farine de maïs précuite, indispensable à la fabrication des repas. Le prix est fixé par décret, au nom de la « défense du pouvoir d’achat ». Sur le papier, l’intention est simple : empêcher les industriels d’augmenter les prix. Dans la réalité, le prix administré est rapidement inférieur au coût réel de production. À court terme, l’État compense partiellement. À moyen terme, l’inflation, la dégradation des infrastructures, la pénurie de devises et les contrôles bureaucratiques rendent cette compensation insuffisante.
L’entreprise dominante du secteur, Empresas Polar, alerte à plusieurs reprises : produire à ce prix signifie produire à perte. Les coûts explosent — énergie, transport, pièces détachées importées — tandis que le prix de vente reste figé. L’État refuse d’ajuster durablement, par crainte politique de reconnaître l’inflation.
La mécanique se met alors en place, implacable. Les usines ralentissent, puis s’arrêtent par intermittence. Les stocks disparaissent des supermarchés. La farine devient un produit rare. Les files d’attente s’allongent devant les magasins d’État. Le rationnement s’installe : un paquet par personne, certains jours seulement, parfois sur présentation de la carte d’identité ou du « carnet de la patrie ».
Dans le même temps, la farine ne disparaît pas vraiment. Elle change de circuit. Les sacs subventionnés sont détournés à la sortie des usines ou des entrepôts, revendus sur les marchés informels à cinq, dix, parfois vingt fois le prix officiel. Le contrôle des prix, censé protéger les plus pauvres, ne profite qu’aux dignitaires du régime. La farine n’est pas un cas isolé. Le riz, le lait, l’huile, le sucre, puis les médicaments, tous les biens de base subissent le même sort.
Dans le même temps, pour empêcher la fuite de capitaux, l’État s’arroge le monopole total de l’accès aux devises.
Acheter des dollars devient un privilège administratif. Toute entreprise souhaitant importer doit demander des devises à un organisme public. Le taux officiel est fixé très en dessous de la valeur réelle du bolivar. Le dollar subventionné devient aussitôt une rente.
Le système produit exactement l’inverse de l’objectif affiché. Les entreprises proches du pouvoir obtiennent des dollars bon marché, parfois pour les revendre sur le marché noir avec des marges énormes, parfois pour des importations fictives qui alimentent les réseaux politiques, militaires et clientélistes.
Les entreprises productives, elles, attendent ou sont refusées. Sans devises, elles ne peuvent plus importer de machines ni de matières premières. La production s’effondre.
Un marché noir du change devient la vraie référence de l’économie. Le pays fonctionne alors avec deux réalités : un taux officiel réservé aux initiés et un taux réel, illégal mais indispensable à la survie.
Sous Nicolás Maduro, le système se complexifie sans jamais être démantelé. Les taux se multiplient, l’arbitraire s’installe, la corruption explose. Le contrôle des changes alimente la fuite de capitaux, accélère la désindustrialisation et prépare l’hyperinflation.
Entre 2000 et 2018, on estime que plus de 150 milliards de dollars ont quitté le pays. Une moyenne de 3,5% du PIB chaque année.
L’inflation atteint 4 % par jour. Ce qui vaut 1 bolivar le lundi en vaut 1,27 le dimanche. 3,12 à la fin du mois. Plus d’un million et demi un an après. En 2021, le salaire mensuel minimum ne permet plus de s’acheter qu’une seule boîte d’œufs.
Si, dans les villes, les dollars sont devenus l’eldorado, dans les villages, c’est le café qui supplante la monnaie nationale. Les grains ne sont plus broyés, ils s’échangent.
Si les sanctions américaines n’ont rien arrangé, elles ne sont pas l’origine de la catastrophe. En 2014, sous la présidence de Barack Obama, Washington se limite à sanctionner individuellement quelques responsables impliqués dans la répression des manifestations. Les premières mesures réelles interviennent en 2017, lorsque Donald Trump coupe l’accès de PDVSA et du gouvernement vénézuélien aux marchés financiers internationaux. Et la rupture décisive ne survient que deux ans plus tard, avec l’interdiction faite aux entreprises américaines d’acheter du pétrole vénézuélien. Pour la première fois, le brut est directement visé. Mais à ce moment-là, la production a déjà été divisée par trois, les pénuries d’essence sont installées, et PDVSA est techniquement sinistrée. Les sanctions ne peuvent pas être la cause d’un déclin commencé bien avant leur mise en œuvre.
Aujourd’hui, près de 8 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. Un quart de la population. Un exode qui a bouleversé la démographie de l’Amérique du Sud : pour la première fois, la Colombie, le Chili et le Pérou ont connu un solde migratoire positif.
Mais la pauvreté n’est pas le seul danger qui menace les Vénézuéliens.
Derrière la misère, la peur
Progressivement, le pouvoir est passé du clientélisme à la terreur, en s’appuyant sur ceux qui dépendaient le plus de lui : les colectivos. Enracinés dans les quartiers populaires, ces groupes pro-gouvernementaux organisent des distributions alimentaires, gèrent des radios communautaires, des jardins partagés, parfois des cliniques de fortune. Ils se présentent comme les « yeux et les mains du peuple », chargés de faire vivre la révolution au niveau local. Avec le temps, une partie d’entre eux a basculé. Ce sont devenus des milices. Les structures sociales se sont transformées en réseaux d’informateurs, puis en instruments d’intimidation, capables de terroriser la population.
En 2024, ils jouent un rôle central dans la répression des manifestations qui suivent la réélection contestée de Nicolás Maduro. Organisés en bandes de motards armés et cagoulés, ils tirent sur les foules ou les brutalisent. Pour intimider, ils peignent des croix sur les maisons des manifestants. À Caracas, presque chaque famille voit alors l’un des siens disparaître. Désignés comme « terroristes », les opposants sont arrêtés et emprisonnés sans procès.
De nombreux opposants, comme María Oropeza, soutien du candidat Edmundo Gonzalez Urrutia, sont kidnappés à leur domicile. Filmée en direct par la militante, la scène fait le tour du monde. Elle est détenue depuis dans le centre de détention d’El Helicoide, connu comme un lieu de torture.Aujourd’hui, les Vénézuéliens vivent dans la peur et dans le dénuement. En dix ans, l’espérance de vie a reculé de plus de trois ans. Et même de sept ans pour les personnes nées entre 2015 et 2020. L’avenir sera-t-il meilleur ? Rien n’est moins sûr. À l’heure où j’écris ces lignes, impossible de savoir si la capture de Maduro mettra fin au chavisme. Espérons-le, tant il fut destructeur.