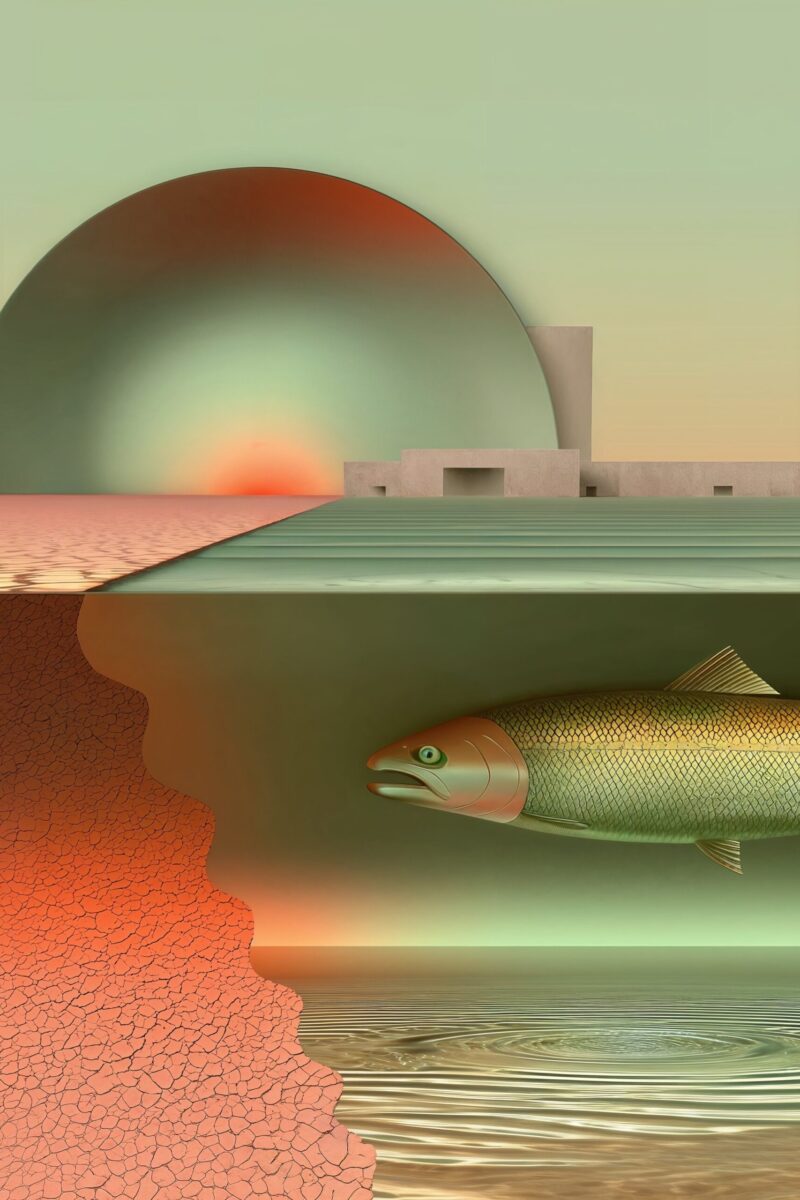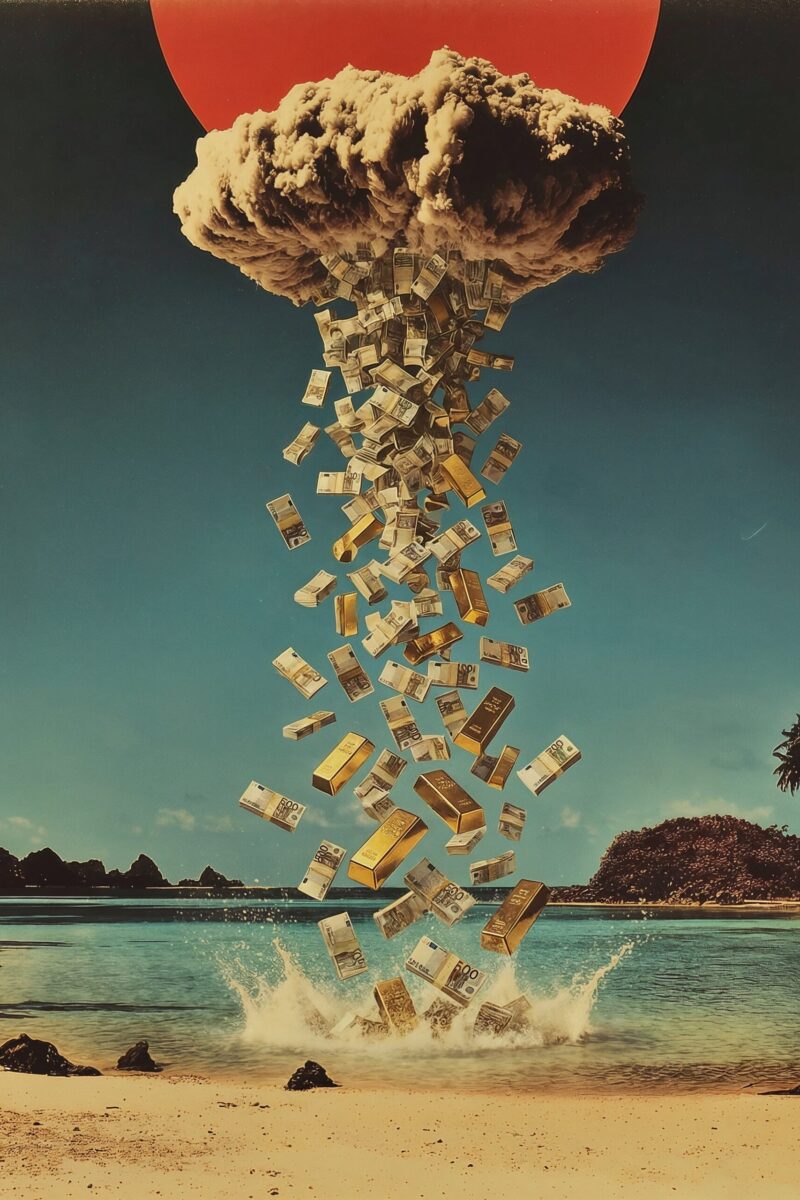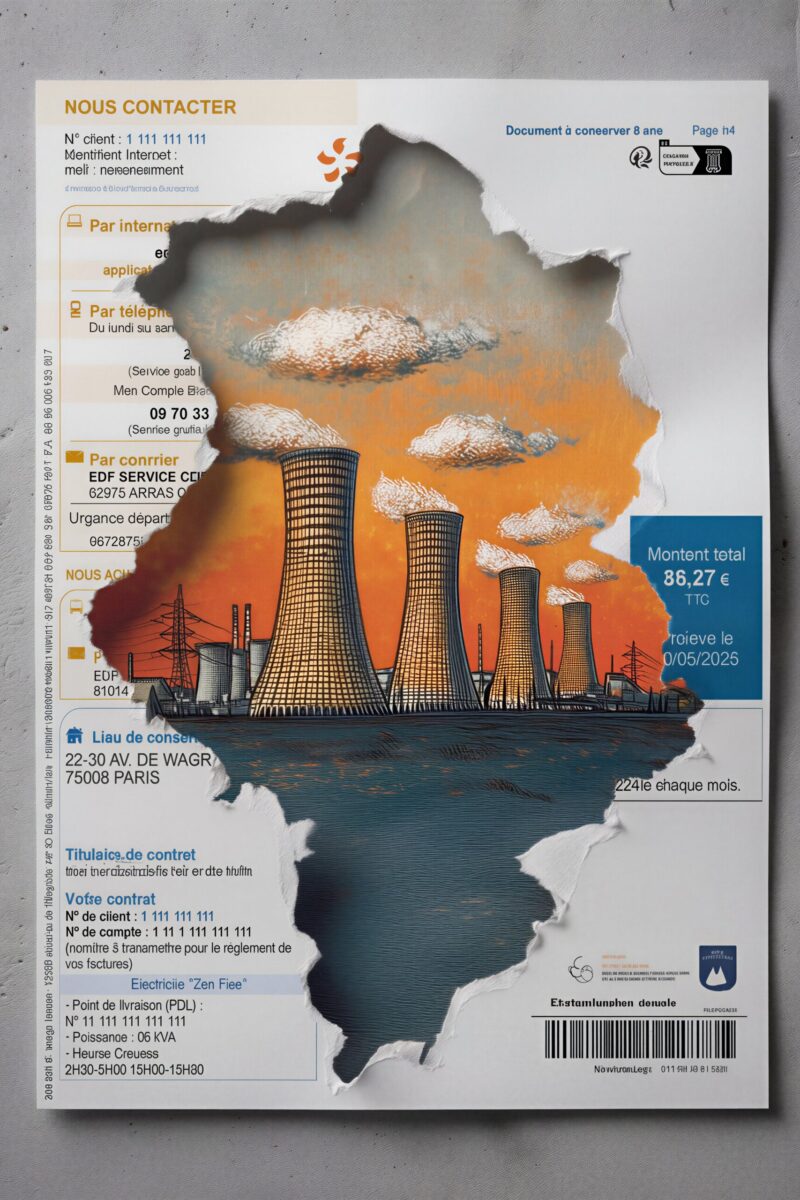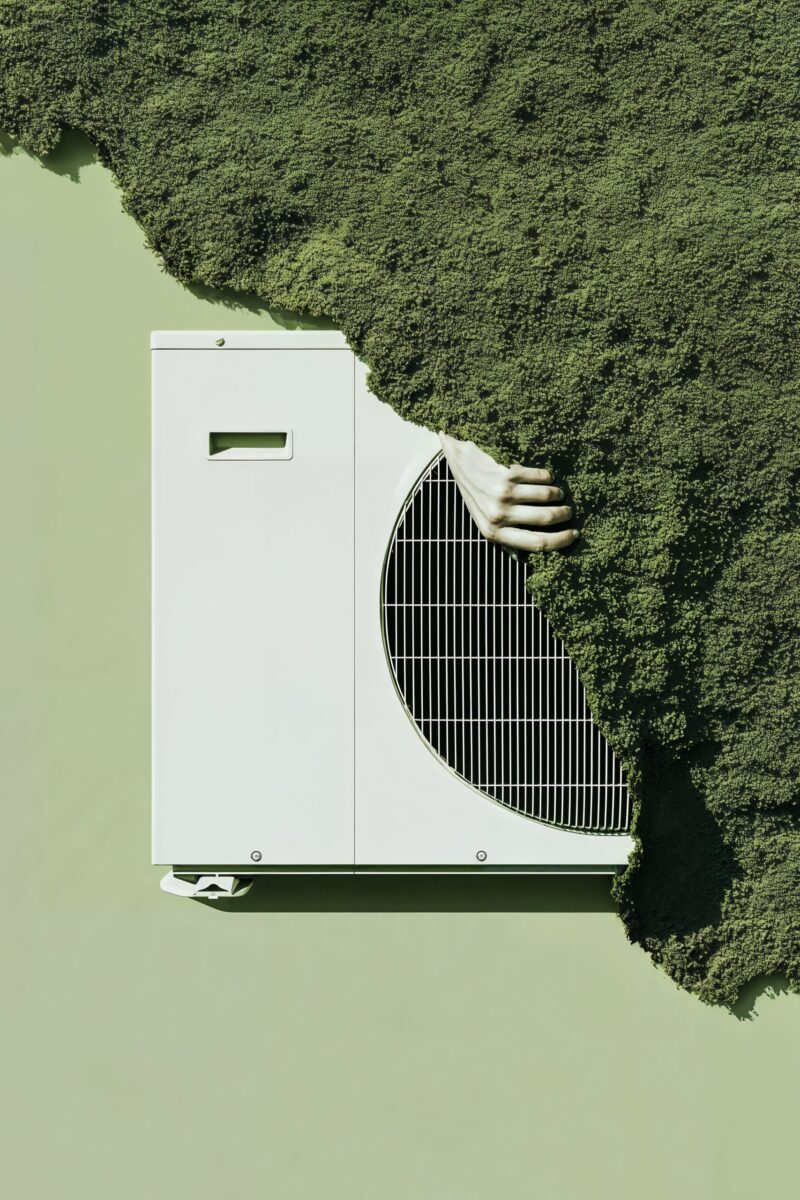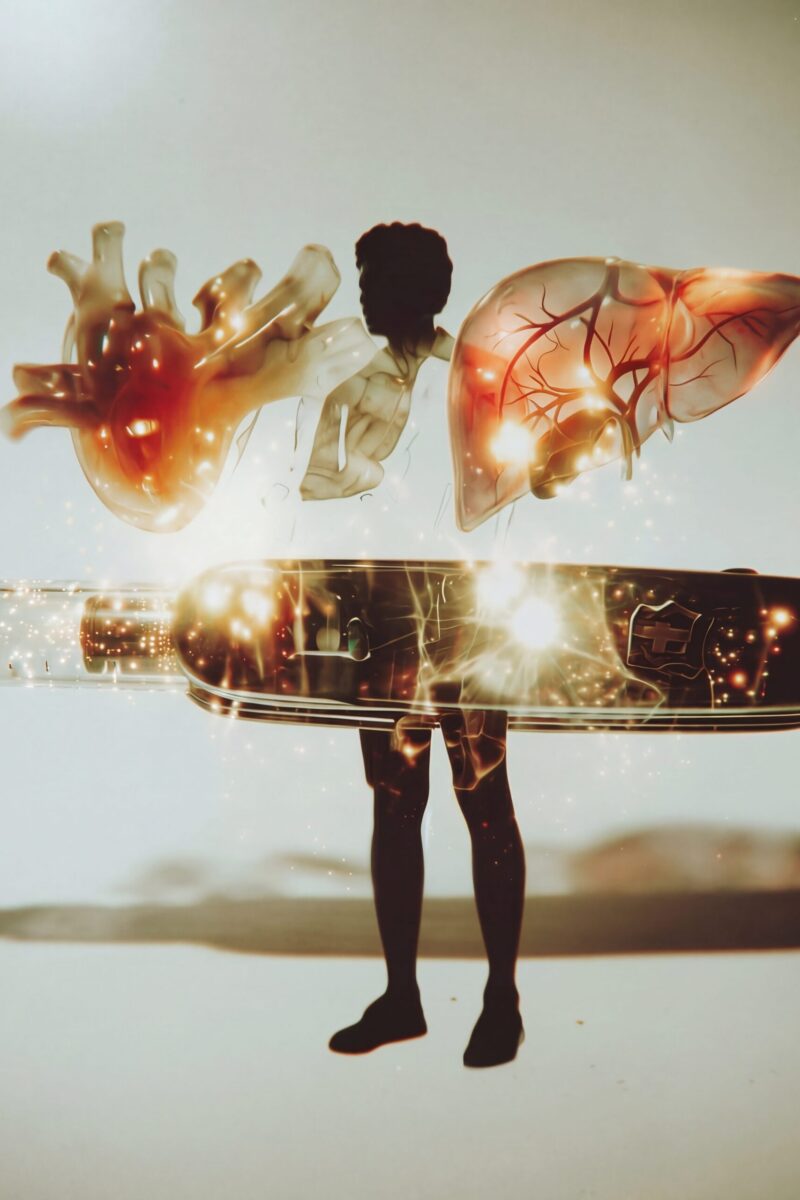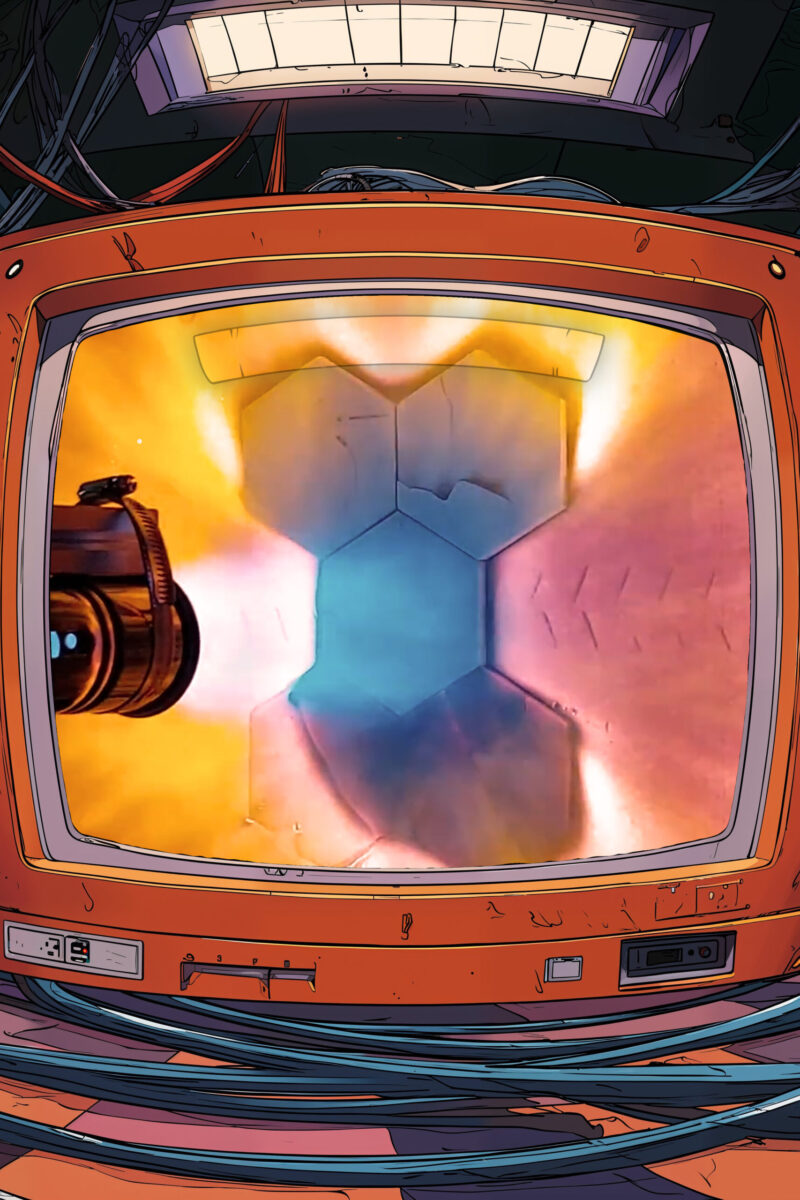On nous dit qu’ils sont dans notre nourriture. Dans notre eau. Même dans notre sang ! Depuis des années, les gros titres de la presse décrivent les microplastiques comme des ennemis invisibles de votre quotidien. Le problème, c’est que tout ceci repose sur des études bâclées.
Dans une étude publiée en octobre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a examiné 122 travaux sur la libération de microplastiques et de nanoplastiques à partir de matériaux en contact avec les aliments, tels que bouteilles, emballages et contenants. Ses conclusions, inhabituelles pour un rapport technique, sont sans détour : nombre de ces études présentent de graves lacunes méthodologiques. Les conditions des tests varient de manière incohérente, les préparations manquent de fiabilité et les outils analytiques peinent à différencier le plastique d’autres substances. Cela génère une grande incertitude quant à la viabilité des résultats, des faux positifs et des données globalement peu fiables.
Certaines erreurs majeures découlent de contaminations. Les particules détectées proviennent souvent de poussières, de fibres textiles ou de matériel de laboratoire, plutôt que des emballages testés. Dans d’autres situations, des additifs ou oligomères libérés par chauffage se déposent au refroidissement et forment des résidus confondus avec des microplastiques. L’EFSA précise également que des microplastiques s’échappent des emballages par abrasion ou friction. Il n’empêche qu’elle reconnaît qu’il « existe bien des preuves de la libération de microplastiques lors de l’utilisation de matériaux en contact avec les aliments… [mais] malgré les incertitudes, cette libération est beaucoup plus faible que ce que rapportent de nombreuses publications. »
Et de voir l’agence conclure qu’à « ce stade, il n’existe pas de base suffisante pour estimer l’exposition aux micro- et nanoplastiques issus des matériaux en contact avec les aliments. » Une invalidation en bonne et due forme de bien des titres anxiogènes ayant barré les unes des journaux ces derniers temps.
Les principales techniques utilisées pour réaliser ces analyses — la spectroscopie Raman et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR, qui identifie les substances par l’absorption de la lumière infrarouge, révélant les liaisons chimiques spécifiques à chaque molécule) — subissent aussi des critiques. Puissantes en principe, elles restent sensibles aux interférences. Additifs, pigments et résidus organiques altèrent les signaux et créent de fausses correspondances avec des polymères. Selon l’EFSA, la plupart des études n’ont pas pris les précautions de nettoyage ou de contrôle nécessaires pour éviter ces artefacts. Comme le note le rapport, une simple inspection visuelle ou l’usage d’une seule méthode « ne peut garantir une identification fiable ».
Le travail de l’EFSA ne se limite pas à la simple critique des études observées. Il propose six recommandations pour en améliorer les méthodes et aider chercheurs et régulateurs : les uns dans l’affinage de leurs analyses, les autres pour fonder les législations sur des bases scientifiques incontestables.
- Développer des méthodes standardisées et validées pour détecter et quantifier les MNP.
- Contrôler la contamination pendant l’échantillonnage et l’analyse.
- Vérifier l’identité des particules à l’aide de techniques complémentaires à celles utilisées, dont les limites ont été exposées.
- Créer des matériaux de référence pour étalonner les instruments.
- Effectuer les tests dans des conditions d’usage réalistes (éviter les solvants ou températures extrêmes).
- Mettre les résultats en perspective, en comparant l’exposition potentielle aux MNP avec d’autres expositions courantes dans la vie quotidienne.
L’agence insiste sur certains points concernant son rapport et la manière dont les études devraient être conduites. Pour elle — et c’est une évidence à sans cesse rappeler — la science doit produire des preuves fiables avant tout débat public sur les risques des microplastiques, même si elle n’affirme pas que ces derniers sont inoffensifs. Mais elle dément les certitudes de cette dangerosité et de son ampleur rapportées par des études approximatives. Elle montre comment un domaine de recherche récent, poussé par des médias à la fois sensationnalistes et parfois militants, qui rencontrent la légitime anxiété du public, outrepasse ses bases méthodologiques.
Cette alerte bienvenue vaut tout aussi bien pour le traitement de sujets comme les produits chimiques, la pollution atmosphérique ou la sécurité alimentaire. L’intervention de l’EFSA impose de considérer la réalité des données avant d’en faire des titres chocs. Or, à l’heure actuelle, trop de publications pâtissent d’insuffisances méthodologiques et de faiblesses analytiques, alors qu’aucune base n’existe pour estimer l’exposition aux microplastiques et ses conséquences — ce qui ne signifie pas qu’il n’existe ni l’une ni l’autre.
Mais dans un contexte où les indignations rapides obtiennent un écho démultiplié entre réseaux sociaux et vidéos médiatiques tronquées, le rappel de l’EFSA constitue une retenue rare. Elle privilégie la précision à la panique et clarifie l’incertitude plutôt que de l’amplifier. Son constat n’occupera peut-être pas les unes de la presse, mais il conforte la science dans sa mission et ses fondements. C’est déjà ça.