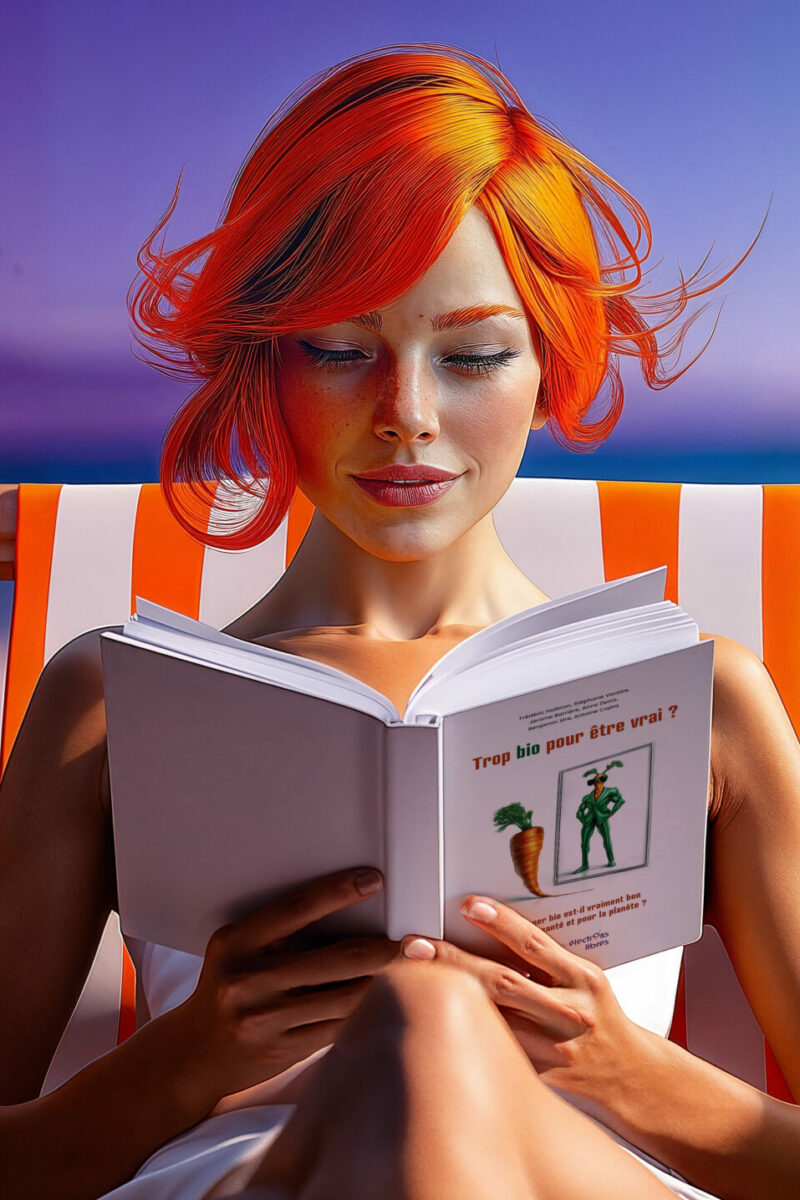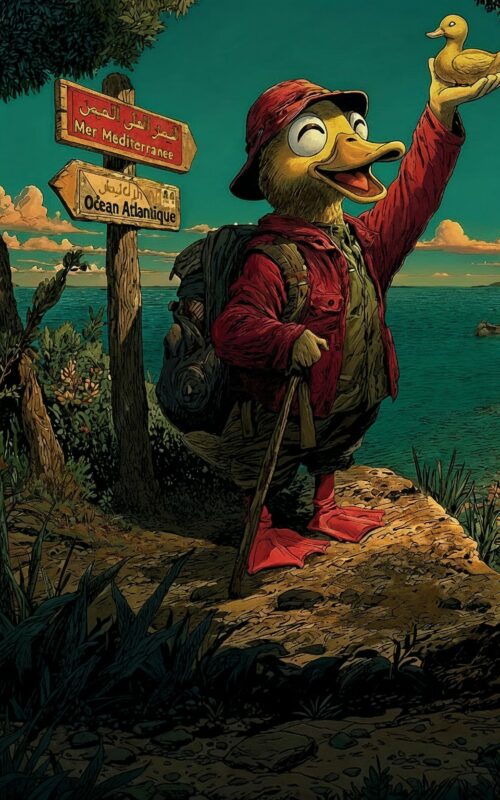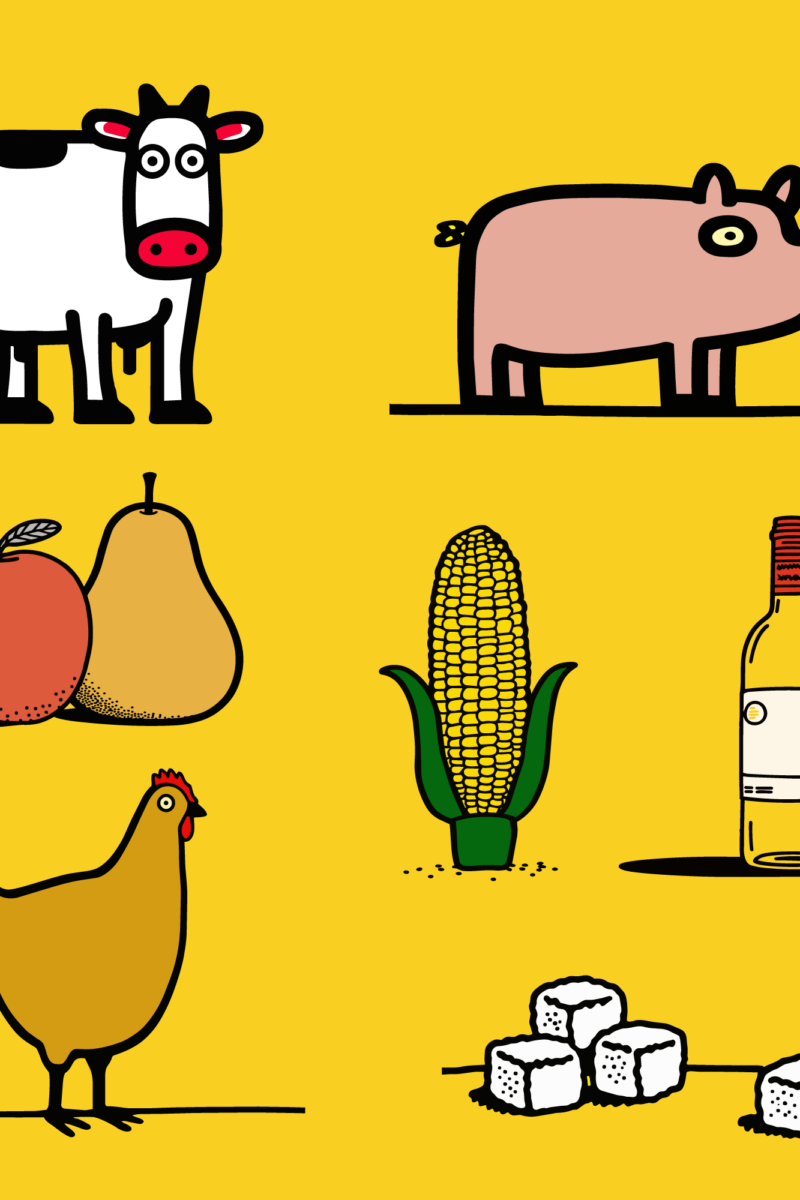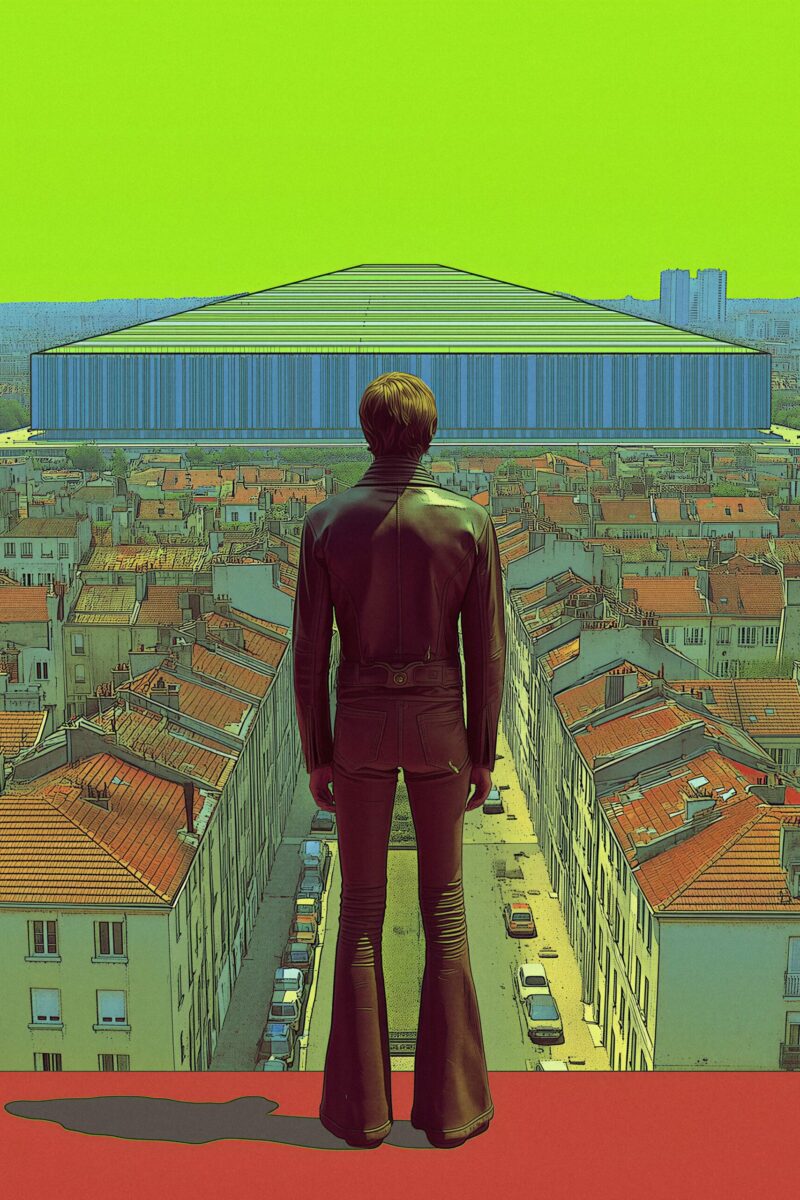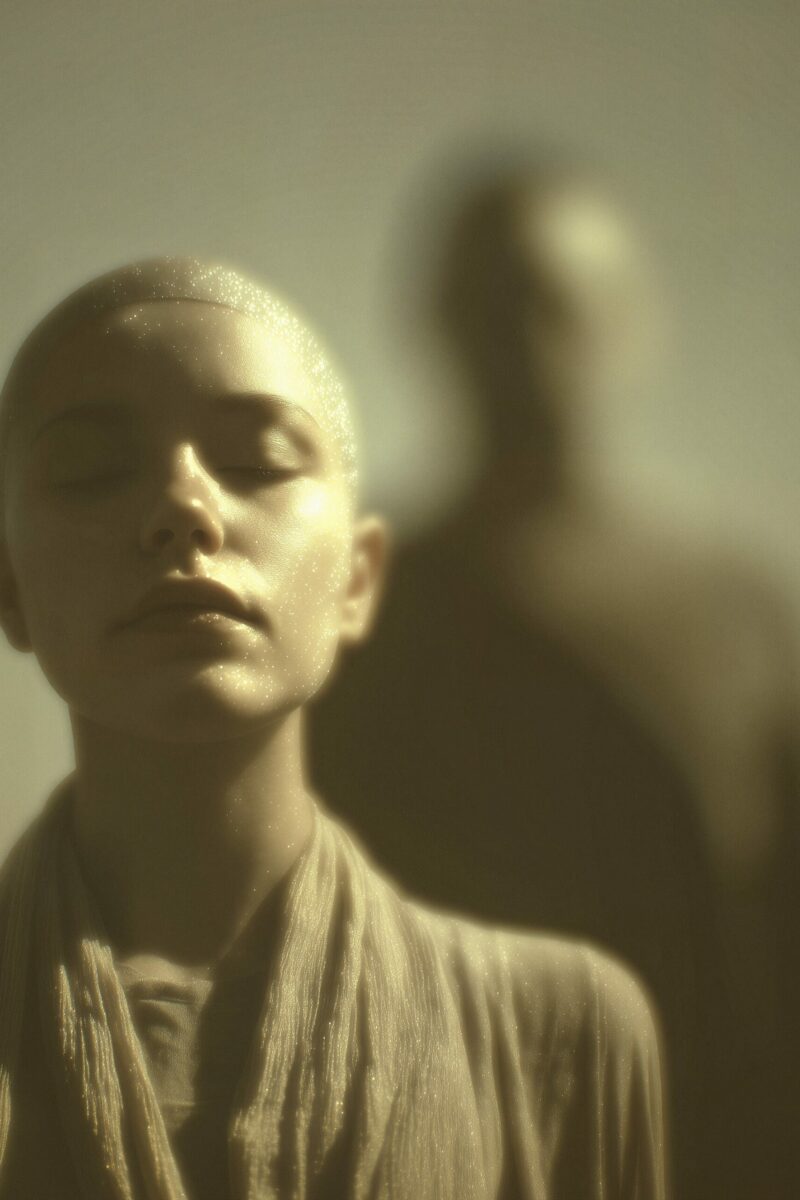Parvenus au terme de ce dossier, force est de constater que l’agriculture biologique ne tient pas ses promesses, malgré certains bénéfices pour les sols et la biodiversité. Ses faibles rendements en font, hors exceptions comme le maraîchage ou la viticulture, un modèle écologiquement moins performant par kilo produit, et plus exigeant en surface agricole. Les produits bio coûtent 20 à 80 % plus cher, sans bénéfice avéré pour la santé, un surcoût qui aggrave les inégalités alimentaires. Le bio devient alors un marqueur social, bien plus qu’un levier de transformation agricole.
La proposition de valeur du bio : au libre choix du consommateur
Sa proposition de valeur devrait relever du libre choix du consommateur, non d’un choix de politique publique. Mais l’écosystème militant et ses relais institutionnels polluent le débat, au bénéfice des distributeurs. Ni les producteurs, ni les consommateurs n’y trouvent réellement leur compte.
Le bio comme LE modèle à suivre pour la transition écologique : une impasse
Mais le principal problème est que l’agriculture biologique, de niche, est désormais promue comme le modèle à généraliser.
Or, rien, de notre analyse, ne saurait justifier la position hégémonique que ses promoteurs, parfois à grand renfort de désinformation, veulent lui conférer dans la transition écologique. Au contraire, l’histoire est jalonnée de catastrophes, voire de tragédies, par l’imposition idéologique de modèles exempts de toute rationalité scientifique. Le réel s’est chargé de rappeler aux apprentis sorciers, et malheureusement à leur population, qu’on ne joue pas impunément avec les besoins fondamentaux de l’être humain.
Nombre d’agriculteurs se sont pourtant engagés dans la démarche avec sincérité, séduits par la promesse d’une montée en gamme et l’espoir de changer le monde. Aujourd’hui, la désillusion est réelle.
Le bio a certes contribué à une prise de conscience de certains excès de l’agriculture productiviste, et, prises isolément, certaines de ses pratiques sont intéressantes. Mais corseté dans un cahier des charges rigide et partiellement idéologique, il reste une solution du XIXᵉ siècle à des problèmes du XXIᵉ.
À l’heure de l’édition génomique, de l’agriculture de précision et de l’intelligence artificielle appliquée aux cultures, aux sols et aux intrants, l’agriculture biologique semble de plus en plus en décalage avec les leviers de progrès qui s’offrent à nous. Ce fossé pourrait accentuer les crispations idéologiques autour d’un modèle qui, refusant d’évoluer, se replie sur le dénigrement de la concurrence et le marketing de la peur — comme en témoignent les débats récents autour de la loi Duplomb.
Il est temps de sortir du monopole moral du bio pour ouvrir un débat rationnel, orienté vers des solutions concrètes aux défis du XXIᵉ siècle : produire plus efficacement, sur moins de surface, pour nourrir tout le monde, mieux, tout en limitant notre empreinte environnementale. Y répondre ne passera pas par un modèle unique, mais par un bouquet d’innovations technologiques et de pratiques agronomiques adaptées — dont certaines, oui, héritées du passé.
Vive l’agriculture bio-techno-logique.
Tout l’été, nous avons publié ici gratuitement les bonnes feuilles de notre livre, « Trop bio pour être vrai ? ». Pour le lire en intégralité, c’est par là :
CommanderÉpisode précédent : Le bio qui cache la forêt