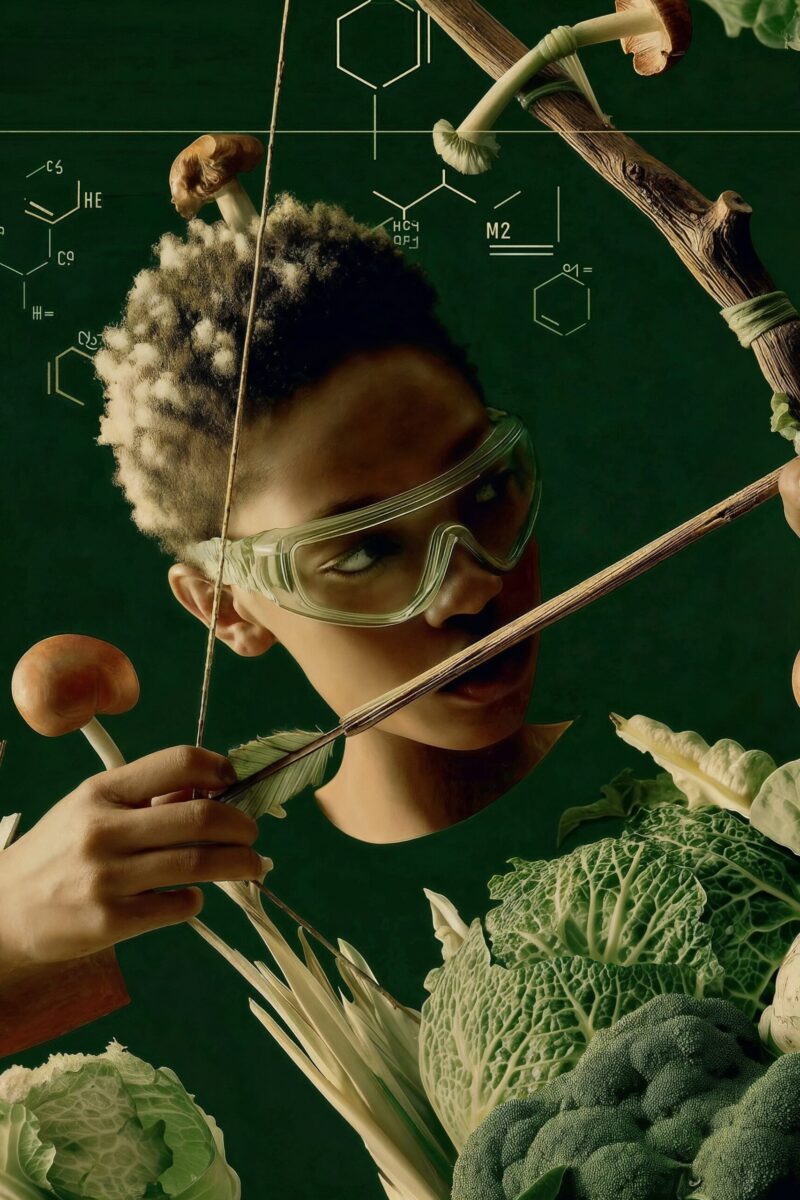« Les data centers ont pompé 560 milliards de litres d’eau ! », « Un kilo de bœuf = 15 000 L d’eau ! », « Le maïs irrigué utilise 25 % de l’eau consommée ! ».
Ce genre de chiffres chocs pullule dans la presse. Et à lire les articles, un constat s’impose : la gestion de l’eau est mal comprise. Par les journalistes, et sans doute aussi par une bonne partie du public.
Or, dans un monde qui se réchauffe, mal comprendre l’eau, c’est risqué. Alors, retour aux sources !
L’eau, une ressource pas comme les autres
Oubliez les gros chiffres qui font peur. Ils sont parfois impressionnants, mais pas toujours pertinents.
Pourquoi ? Parce que l’eau, ce n’est pas du charbon. Chaque tonne de charbon brûlée part en fumée et disparaît à jamais, contribuant au réchauffement climatique. Et son extraction puise dans un stock limité. L’eau, elle, suit un cycle. Elle revient. Toujours.
Raisonner en “stock”, comme pour le charbon ou le pétrole, n’a donc pas beaucoup de sens. Il faut raisonner en flux : ce qui compte, ce n’est pas combien on prélève, mais où, quand, et surtout à quelle vitesse l’eau se renouvelle dans le système considéré.
Évidemment, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas manquer d’eau. Si on prélève trop à un endroit ou à un moment où elle se renouvelle lentement, on crée un déséquilibre. Mais si on prélève moins que ce que le système peut absorber : aucun problème.
Les risques causés par les prélèvements d’eau
En réalité, il n’y en a que deux :
-Le conflit d’usage, qui peut mener à des restrictions, voire à des pénuries pour certains usagers.
-Les atteintes aux écosystèmes aquatiques, si on puise dans un milieu déjà fragilisé.
Ces risques peuvent être immédiats ou différés, selon la nature du prélèvement et du milieu concerné.
Pour bien comprendre, passons en revue trois cas concrets.
Le cas des cours d’eau
Prenons une rivière. L’eau y file vers la mer. Un prélèvement dans ce type de milieu n’aura donc que des effets immédiats. Si, au moment du prélèvement, le débit est correct, il n’y a pas de problème, donc aucune raison de s’en priver.
En revanche, si le niveau est bas, chaque litre retiré peut avoir des effets directs sur l’écosystème : dans le lit du cours d’eau lui-même, ou à l’estuaire, où l’eau douce est cruciale pour les espèces côtières.
C’est pourquoi des seuils de gestion sont définis dans les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). Le débit d’alerte marque le moment où les usages commencent à être limités. Et le débit de crise est le seuil en dessous duquel seuls les usages essentiels (santé, sécurité civile, eau potable, besoins des milieux naturels) sont autorisés.
Ces seuils sont fixés localement, par concertation entre les acteurs du territoire, sur la base d’expertises scientifiques et du Code de l’environnement. On peut donc leur faire confiance.
Cas d’une nappe inertielle
Les nappes phréatiques sont des volumes d’eau souterrains. On parle de nappes inertielles lorsque leur niveau varie peu au fil des saisons, car elles se rechargent très lentement. C’est par exemple le cas sous le bassin parisien.
Prélever dans une nappe inertielle revient à puiser dans ses économies : il n’y a pas d’effet immédiat sur les écosystèmes (personne ne vit à plusieurs dizaines de mètres sous terre), mais si on puise plus que ce qui se recharge chaque année, on épuise la ressource à long terme.
La bonne nouvelle, c’est qu’on sait suivre cela. Le BRGM publie régulièrement des bulletins sur l’état de remplissage des nappes. Si elles sont bien remplies, on peut les solliciter. Si elles sont basses, on ralentit les prélèvements. Ce suivi permet d’anticiper les tensions et d’éviter les déséquilibres.
Cas d’une nappe réactive
À l’inverse, certaines nappes réagissent très rapidement aux pluies et aux sécheresses. On les appelle nappes réactives. Elles sont souvent très connectées aux rivières et aux zones humides.
C’est le cas typique dans les Deux-Sèvres, où ont été installées les controversées mégabassines (cf. https://lel.media/stockage-de-leau-solution-ou-illusion/). Dans ces nappes, tout prélèvement peut avoir un impact quasi immédiat sur les milieux aquatiques. Mais il peut aussi y avoir des conséquences différées, dont la latence dépendra de la réactivité de la nappe. Pour une nappe très réactive comme dans les Deux-Sèvres, on estime qu’un prélèvement peut avoir des conséquences sur le remplissage de la nappe jusqu’à environ un mois après.
C’est précisément pour cela que les retenues de substitution (alias « mégabassines ») ne se remplissent qu’en hiver, quand l’eau est abondante. Avec une marge de sécurité de quelques semaines pour prendre en compte l’impact différé. Et pour éviter les risques immédiats, les pompages ne sont autorisés que lorsque les niveaux sont suffisants.
Autrement dit : on pompe uniquement quand l’eau est disponible, et sans compromettre les milieux.
Ce qu’il faut retenir
Tous les prélèvements d’eau ne se valent pas.
Pomper dans une rivière en crue ? Aucun souci. Pomper dans une nappe réactive à sec en plein été ? Mauvaise idée.
L’eau n’est pas une ressource à bannir, mais à gérer intelligemment. Contrairement au charbon ou au pétrole, on peut en utiliser sans dommage… si on respecte certaines règles. Et cela, la France le fait déjà plutôt bien, via les SAGE, les seuils de gestion, et le suivi des nappes. Alors non, l’irrigation n’est pas « le mal ». Ce qui compte, c’est quand, où et comment on irrigue. Tant que cela reste encadré, raisonné et conforme aux règles collectives, il n’y a aucune raison d’en faire un scandale.